De Sylvaine Landrivon
Alors que vient de sortir le premier roman Pleine et douce,  de Camille Froidevaux-Metterie, qui illustre avec finesse le contenu de ses derniers essais, l’idée m’est venue de partager le contenu d’Un corps à soi, pour celles et ceux qui n’ont pas le temps (ou l’envie) de lire de la philosophie, mais qui s’intéressent à ce que le corps féminin dit des femmes et de leur être au monde. Voici donc ci-dessous, ce que j’ai retenu et compris de ce livre, en guise peut-être d’introduction ou comme prolongement de la lecture du roman qu’il faut -lui-, lire absolument.
de Camille Froidevaux-Metterie, qui illustre avec finesse le contenu de ses derniers essais, l’idée m’est venue de partager le contenu d’Un corps à soi, pour celles et ceux qui n’ont pas le temps (ou l’envie) de lire de la philosophie, mais qui s’intéressent à ce que le corps féminin dit des femmes et de leur être au monde. Voici donc ci-dessous, ce que j’ai retenu et compris de ce livre, en guise peut-être d’introduction ou comme prolongement de la lecture du roman qu’il faut -lui-, lire absolument.
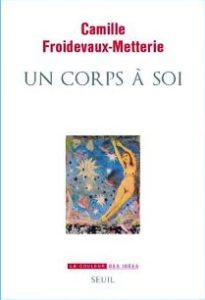 Camille Froidevaux-Metterie, Un corps à soi, Paris, Seuil, 2021 382p.
Camille Froidevaux-Metterie, Un corps à soi, Paris, Seuil, 2021 382p.
Comment aborder le corps féminin en philosophe phénoménologiste féministe ? Il faut d’abord revenir sur les bases historiques de la prise en compte féministe du corps des femmes. Cela demande bien sûr de revisiter Simone de Beauvoir et, pour beaucoup, de découvrir la position d’Iris Marion Young sur le sujet. L’autrice nous invite alors à observer le corps féminin selon six axes : le corps empêtré, le corps objectivé, le corps à disposition, le corps de désir, le corps procréateur et le corps sous les regards. Il s’agit au fil de cette étude de donner les appuis et illustrations nécessaires pour construire à partir d’un corps-objet, un corps-sujet. Et pourquoi pas « faire advenir un monde où les femmes ne soient plus définies par leur corps.» (p.9).
L’introduction rappelle le temps où les femmes n’étaient que des corps assignés à la sexualité et à la maternité. « Cette condition doublement objectivée et aliénée a permis que s’enracine et se perpétue l’organisation patriarcale du monde, jusqu’à ce que la révolution féministe des années 1970 vienne l’ébranler en libérant les femmes du carcan de leur corps procréateur » (p.9).
On enseigne depuis Aristote que la femme possède une existence inférieure en son essence, et qu’elle n’a comme charge que celle « d’assurer le renouvellement des générations et de pourvoir aux besoins quotidiens de la famille ». Ce sont les arguments que reprendra Thomas d’Aquin et que ni les Lumières ni la révolution française, ne remettront en question. Seul un écrivain que l’autrice ne mentionne pas : François Poullain de la Barre, au XVIIe siècle, s’est insurgé contre les discriminations dont les femmes étaient victimes dans De l’égalité des sexes.
Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que naissent les premiers combats féministes qui réclament d’inclure les femmes dans l’horizon de liberté et d’égalité de la démocratie, avec le droit de vote. « Dans un mouvement qui n’aura de paradoxal que les apparences, c’est en brandissant leur capacité maternelle que la plupart des militantes de la première vague réclament de participer pleinement à la chose publique.» (p.13). Pour toutes à cette époque : aux USA (Judith Sargent Murray), en Angleterre (Mary Wollstonecraft), en France avec Olympe de Gouges, la maternité est vue comme une fonction sociale importante « au même titre que le service militaire ». Le rôle maternel a donc été « le point de départ obligé de leur action » (p.15). Il faudra attendre Simone de Beauvoir puis les années 1970 pour dénoncer la domination masculine sur le corps des femmes et dissocier enfin sexualité et maternité. Mais alors, les femmes entreprennent d’investir la sphère sociale et « le féminisme se divise et s’émiette, il perd aussi de vue ce qui était au cœur théorique de ses luttes, la volonté de libérer les femmes de leur corps-carcan » (p. 17). Dès lors, « les féministes ne parlent plus du corps des femmes. Dans un contexte de découverte et d’études de genre/queer, l’essentiel de la vitalité théorique et militante se concentre sur la dénonciation et la déconstruction des ressorts de l’hétéro normativité » (p. 19).
Ce contexte posé, l’autrice énonce un double postulat sur lequel elle va appuyer son analyse phénoménologique : « l’existence comme subjectivité ne fait qu’un avec l’existence comme corporéité » et « la sexuation des corps modifie grandement les expériences vécues par le sujet incarné » (p.20). Mais gare au risque d’essentialisme porté par le mot « féminin » !
Nous savons que dans un perspective égalitariste, E. Badinter, C. Delphy dénoncent le risque de ranimer le « brasier patriarcal » en réinvestissant la corporéité des femmes. C’est là que s’énonce l’originalité de la position de Camille Froidevaux-Metterie. Elle sait que « toute tentative pour penser la matérialité sexuée de la corporéité féminine subit aussitôt l’accusation d’essentialisation sous le feu de trois critiques : le refus de spécifier d’aucune façon l’existence des femmes (universalisme), le rejet de l’hétérosexualité obligatoire et de ses implicites corporels (matérialisme lesbien), la volonté de s’extirper du cadre binaire féminin/masculin (études de genre/queer). » (p.21). Face à cela, elle soutient qu’il doit être possible de penser le féminin selon une démarche féministe en évitant l’ornière essentialiste, mais à condition de bien distinguer ce qui relève de la féminité et ce qui appartient au féminin au sens phénoménologique du terme.
Elle pointe la triple injonction de la féminité qui condense « le projet patriarcal tel qu’il est imposé aux femmes depuis les origines » : disponibilité sexuelle, dévouement maternel et subordination sociale. Cette « féminité » s’articule à la « virilité », elle-même porteuse de trois injonctions en miroir : conquête sexuelle, accomplissement individuel et domination sociale.
Mais, le féminin n’est pas la féminité ! Camille Froidevaux-Metterie propose de définir le féminin « comme un rapport à soi, aux autres et au monde qui passe nécessairement par le corps » (p.22) alors que « le masculin désigne un rapport à soi, aux autres et au monde faisant abstraction du corps », car les hommes n’ont pas à pâtir du fait qu’ils ont un corps sexué. Et, pour l’autrice, « s’il y a bien des femmes qui endurent tous les maux associés au fait d’être un corps féminin, ce sont les femmes trans ».
Elle annonce enfin son projet d’aborder le sujet par la dimension phénoménologique, d’où son recours à Iris Marion Young, pour argumenter le dépassement d’une opposition inopérante entre féminisme universaliste et féminisme différentialiste. Elle développera le fait que s’il est désormais incohérent de définir la condition des femmes à travers le prisme de la procréation, c’est cependant « leur capacité procréatrice [qui] a permis aux femmes de refuser d’être définies à l’aune de leur destin maternel » (p.27). Elle rappellera alors que « ce que sont devenues les femmes depuis qu’elles ont pris le contrôle de leur corps procréateur est si radicalement nouveau qu’il faut imaginer de nouveaux outils conceptuels pour en saisir la portée (p.27). Et comme elle place le féminisme dans le domaine du politique, elle admet qu’il soit « pluriel et conflictuel ».
Pour entrer dans le vif du livre
Le premier chapitre reprend l’histoire des femmes par rapport à leur corps. Les années 1970 veulent libérer les femmes de leur assignation à l’espace domestique. « Il s’agit dès lors de refuser la conjugalité et la maternité obligatoires qui forment le socle de la société patriarcale en conquérant le pouvoir de maîtriser son corps procréateur.[4] » (p.33). S’affranchir du « destin » maternel, tel est le but du MLF. C’est le temps du Manifeste des 343, (1971) celui du procès de Bobigny où Gisèle Halimi plaide pour soutenir sa jeune cliente violée à 14 ans (1972) qui s’est fait avorter. En « débarrassant les femmes du joug de la maternité impérative et en les autorisant ainsi à devenir des sujets pleinement sociaux, [les femmes] font leur entrée dans la modernité démocratique » (p.36). Il y a alors confrontation avec le féminisme différentialiste (Antoinette Foulque) car « à trop exalter la singularité féminine enracinée dans le maternel, le féminisme différentialiste perpétuerait la binarité sexuée et l’assignation des femmes à leur prétendue nature. (…) Pour la majorité des féministes françaises en effet, la revendication de l’égalité paraît difficilement conciliable avec l’affirmation d’une spécificité féminine, fût-elle puissante » (p.40).
Débarrassées du risque de grossesse non voulue par la contraception, les femmes vont enfin pouvoir vivre une sexualité dissociée de la procréation comme de la conjugalité.
Dans le même temps, les féministes radicales américaines s’attaquent au fondement du système patriarcal en affirmant que le privé est lui aussi politique. Le mouvement NOW (National Organisation for Women) créé en 1966 veut parvenir à un partenariat égalitaire dans tous les domaines.
Un peu avant, par les polémiques qu’il a suscitées dès sa sortie, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir a enfin permis de « faire advenir la parole là où régnait le silence », comme l’écrit Sylvie Chaperon, mais il faudra du temps pour cette analyse soit redécouverte et que soit mise en évidence sa dimension phénoménologique. L’objectif de l’autrice dans le présent ouvrage sera de montrer comment Simone de Beauvoir « réussit à tenir ensemble la caractérisation du corps féminin comme lieu par excellence de la souveraineté mâle et sa redéfinition comme premier vecteur de l’émancipation » (p.65).
Beauvoir est proche de son ami Merleau-Ponty qu’elle rejoint sur l’importance des conditions historiques et sociales de la liberté. Contre Sartre, qui a relégué la question de la différence sexuelle hors du champ de la philosophie, elle se rapproche de Merleau-Ponty qui affirme qu’il faut en finir avec la césure entre le spirituel et le corporel, entre la raison et les sens Il écrit notamment dans sa Phénoménologie de la perception : « je suis un corps qui se lève vers le monde ». C’est à partir de ce concept de sujet situé, que Beauvoir « déploie une pensée de l’oppression des femmes subissant, dès l’enfance et jusque dans leur maturité, injonctions, rappels à l’ordre et violences » (p.68). Mais alors que pour Merleau-Ponty les conduites du corps sont peu, voire pas, lestées de sens social, Beauvoir postule une « dépendance de la conscience du corps vis-à-vis des déterminants collectifs ». Et surtout, elle réagit contre la perception essentialisante de son ami qui donne à la sexualité un caractère quasi ontologique, renvoyant à un corps universel, générique, assimilable au corps mâle, ou qui, au mieux, comme chez Husserl, conduit à une sorte de neutralité qui gomme la différence sexuelle.
« Toute l’originalité et la puissance de la philosophie beauvoirienne consistent précisément dans une ressaisie de la phénoménologie à travers le prisme de la sexuation pour montrer que la différenciation sexuée des corps implique de distinguer entre les individus dont l’essentielle liberté est sans limites, les hommes, et d’autres qui ne peuvent tout simplement pas aspirer à en déployer les possibilités, les femmes » (p.72).
Nous savons que Simone de Beauvoir dénonce l’assignation des femmes à ce que les freudiens considèrent comme leur « destin » et qui les a durablement privées des bénéfices d’une existence libre. Mais elle pointe aussi une certaine forme de consentement, de complicité à leur infériorité, ce que la philosophe Manon Garcia souligne d’une certaine façon dès le titre de son ouvrage : On ne naît pas soumise, on le devient[1]. En effet, la soumission devient chez certaines femmes, une forme de prise de pouvoir et le système patriarcal est si fort qu’il permet de combiner « l’obéissance consentie (en échange des gratifications matérielles qui permettent la vie de la famille) et de la soumission arrachée (par la violence de la domination masculine) » (p. 82).
D’autre part, Camille Froidevaux-Metterie alerte sur les dérives des héritières de Simone de Beauvoir.
Beauvoir place au cœur de son analyse –notamment dans le tome 2 du Deuxième sexe– l’expérience vécue des femmes « que caractérise l’indissolubilité de la subjectivité et de la corporéité. » (p. 82). Il ne faut donc pas omettre le corps des femmes, et son importance dans l’analyse de la situation. Ainsi, pour elle, « en terminer avec la servitude domestique et l’objectivation sexuelle, ce n’est donc pas nier sa condition sexuée, mais la redéfinir sous l’angle de la liberté » (p.82). Il n’est pas question de parvenir à un universalisme qui alignerait la condition féminine sur le masculin comme l’affirme Elisabeth Badinter quand elle définit le féminisme beauvoirien comme « une politique de la mixité fondée sur la philosophie de la ressemblance[2] ». Au contraire, l’objectif est de révéler les implications aliénantes de la corporéité pour penser ensuite les voies d’une émancipation pleinement incarnée. Ce point est majeur, et d’ailleurs Beauvoir l’écrit : « L’homme est un être humain sexué. La femme n’est un individu complet, et l’égale du mâle, que si elle est aussi un être humain sexué. Renoncer à sa féminité, c’est renoncer à une part de son humanité[3] ».
Les luttes féministes qui ont suivi ont privilégié les combats sociétaux et délaissé les thématiques corporelles, une fois acquis les droits à la contraception et à l’avortement dans les sociétés occidentales. C’est à ce moment que l’autrice découvre les travaux d’Iris Marion Young qui produit sur elle l’effet « d’une épiphanie intellectuelle » (p.86).
Iris Marion Young, américaine de Chicago (1949-2006) est une figure importante de la philosophie politique féministe, très peu connue en France, peu traduite. Elle note le passage par l’oubli de leur corporéité, incontournable à la libération des femmes, mais oppose à cette tendance celle d’un « féminisme gynocentrique » qui veut retrouver les valeurs positives associées au corps féminin, bien consciente toutefois du danger d’une dérive essentialiste. Et c’est là tout son sujet : « comment penser le corps des femmes dans ses dimensions spécifiquement sexuées sans tomber dans l’ornière essentialiste ? Comment articuler l’idée que la subjectivité féminine est indissociable de la corporéité (…) tout en gardant la perspective de la destruction des ressorts patriarcaux de la soumission féminine » (p.89). L’autre écueil pointé est celui qui consisterait à universaliser le vécu de cette corporéité. « Toute l’originalité de la démarche de Young se donne à voir dans cette ambition : tenir ensemble l’analyse de la subjectivité féminine et la compréhension des mécanismes sociaux qui entretiennent la domination masculine » (p 99). Enfin, en phénoménologiste expérientielle, elle revendique d’écrire en première personne.
C’est également la démarche choisie par Camille Froidevaux-Metterie. Elle la présente ainsi : « les femmes étant projetées dans un monde régi par des structures de contrainte qui limitent leurs capacités d’action et contraignent leurs capacités réflexives, elles éprouvent en commun une condition de subordination dont les modalités varient au regard de la diversité des situations singulières et de la pluralité entrecroisée des facteurs d’oppression. Immergées dans une société patriarcale qui les contrôle et les assigne, elles font l’expérience quotidienne de leur corporéité objectivée et aliénée. Il s’agit donc de saisir le sens que revêtent pour elles les dimensions incarnées de leur existence dans le cadre d’un système qui leur dénie a priori toute agentivité et toute liberté (…) Mais, la mise au jour des aspects invariants des phénomènes observés doit s’accompagner d’une forme de relativisation réflexe interdisant toute généralisation » (p.108).
La seconde partie du livre entreprend donc de relever le scandale que constitue l’instrumentalisation et l’appropriation du corps des femmes, lesquelles demeurent toujours assignées à la disponibilité sexuelle et domestique, par-delà même le tournant de la révolution féministe.
Cette nouvelle partie s’intitule « Déjouer le drame féminin et se réapproprier nos corps ».
L’autrice va cheminer selon le temps de l’évolution des corps et commence par la naissance et l’enfance dans « un corps empêtré ».
Désormais la science permet d’assigner un rôle genré avant même la naissance. Les jouets, les vêtements, les objets entretiennent ces rôles. Pourtant, le peu d’études réalisées sur des enfants de couples gays ou lesbiens montrent qu’ils « développent des répertoires de rôles féminins ou masculins moins stéréotypés » (p.124).
Le corps « empêtré » que décrit l’autrice se révèle dans la manière dont bougent les filles qui intègrent tôt des stéréotypes comme par exemple l’impossibilité pour les femmes d’être des corps puissants. « Empêchées d’éprouver toutes les potentialités physiques de leur corps, tenues de toujours se retenir, se limiter, s’interdire, les femmes vivent le plus généralement dans l’ignorance de leur puissance d’agir et de faire. »(p.139). Tel est selon l’autrice le premier des stéréotypes à déconstruire.
Vient ensuite la rencontre avec ce qui constitue le socle du système patriarcal : l’enfermement des femmes dans une corporéité sexualisée qui les assigne à un rôle « sexué-sexuel » face à des hommes qui s’imposent comme « sexués-universels ». C’est ce que l’autrice nomme « le corps objectivé », un corps féminin qui se définit par sa fonction procréatrice et qui fait que pour les filles sexuation devient synonyme de sexualisation.
Camille Froidevaux-Metterie explique qu’il ne va pas de soi « d’être un corps féminin, et c’est un leurre de s’imaginer pouvoir vivre comme si nous n’en avions pas » (p.174). Des expériences spécifiques constituent la vie dans un corps de femme, et d’abord tout ce que véhicule la perte de la virginité. « Personne n’apprend aux filles qu’elles peuvent vivre cette première fois de façon sereine, progressive et agréable (…) les adolescentes vivent ainsi dans l’attente angoissée de cette quasi-épreuve sans l’insérer dans le processus plus englobant de l’apprentissage de la sensualité et du plaisir » (p.142-143). Elle dénonce un corps qui devient objet face à la puberté masculine toujours gratifiante.
L’autrice aborde ensuite longuement le sujet de la menstruation.
Comme l’écrit Françoise Héritier dans Masculin/Féminin, ces règles qui sont « incontrôlables » constituent pour les femmes une inégalité qui constitue la source de la « valence différentielle des sexes ». Il y a « d’un côté, l’activité de ceux qui décident de l’émission du liquide séminal, de l’autre, la passivité de celles qui ne peuvent que subir l’épanchement corporel ; d’un côté le solide et le permanent, de l’autre la fluidité et l’instable ; d’un côté le supérieur et le dominant, de l’autre l’inférieure et la soumise » (p.152).
Elle repère dans l’importance qu’a prise la question de la précarité menstruelle, le fait que cette expérience ne renvoie à aucun universel et ne fait que « se décliner à travers le prisme de l’entremêlement des facteurs de discrimination et d’oppression. » (p.158).
Contre Beauvoir pour qui les femmes sont légitimes dans la sphère sociale mais en faisant disparaitre les caractéristiques féminines associées à leur corporéité, elle fait intervenir Young pour qu’apparaisse enfin une facette positive à l’expérience vécue des règles, car trop souvent « le prix à payer pour qu’une femme soit acceptée comme normale, c’est de rester cachée dans un placard en tant que personne menstruée ». Et l’autrice note au passage que « la métaphore du « placard menstruel » a ceci de commun avec celle du placard homosexuel qu’elle symbolise la puissance du contrôle social qui génère honte et discriminations (p. 162).
Il s’agit désormais de reprendre possession de son corps, y compris contre « ce long déni du corps des femmes véhiculé par un féminisme soucieux de construire une égalité en principe générique mais en réalité conçue sur le modèle de la corporéité masculine[4] » (p.165).
C’est ce que font les partisanes de « l’écologie corporelle » qui confèrent une signification existentielle à la menstruation. Nous observons donc deux pôles : celui du souhait d’annihiler le signe menstruel de l’ovulation pour se libérer des astreintes corporelles, et celui du désir de réinvestir la matérialité des règles dans une perspective assumée.
Mais toujours ce corps sexué entre dans le domaine sexuel et court le risque de devenir un « corps à disposition », ce qui constitue le chapitre suivant du livre.
L’autrice alerte sur le fait qu’aussi longtemps que la sexualité sera placée sous le signe de l’irrespect et de la violence, « il n’y aura que la ruine des corps qui auront été traités comme des objets et la dévastation des vies qui auront été volées » (p.178). Elle dénonce le fétichisme de la virginité qui, dans toutes les civilisations, « reste synonyme de contrôle social sur le corps des femmes et d’emprise masculine sur leur sexualité » (p.178). Elle cite encore Simone de Beauvoir (p 180) qui voit dans le culte de la Vierge Marie un condensé de la position catholique dans lequel : « la répugnance du christianisme pour le corps féminin est telle qu’il consent à vouer son Dieu à une mort ignominieuse mais qu’il lui épargne la souillure d’une naissance », voyant dans le dogme de la naissance virginale du Christ « une suprême victoire masculine » et dans le culte marial « la réhabilitation de la femme par l’achèvement de sa défaite[5] ».
Cette mise à disposition des corps féminins va provoquer divers désordres puisque la plupart du temps, ce n’est pas le désir lui-même qui va occasionner le début de la vie sexuelle féminine, mais des injonctions extérieures au point que lorsqu’il est question de la « première fois », il ne s’agit le plus souvent que d’évoquer la première pénétration vaginale d’un pénis… et certainement pas de la découverte du premier plaisir sexuel. S’en suit ce qu’il est possible d’assumer selon les cas.
Les désordres évoqués qui font suite à une violence sexuelle, sont surtout ceux de l’anorexie illustrée notamment par l’expérience décrite par Annie Ernaux dans Mémoire de fille.
Alors que les années 1970 plaçaient la sexualité dans le champ de la liberté, débarrassée de la maternité vécue comme un destin, on a vite compris que cela ne changeait pas grand-chose quant à l’accès des femmes au plaisir. La mise en lumière des violences sexuelles par l’affaire Weinstein le prouve. Le chapitre sur le corps de désir refait l’historique du rapport des femmes au plaisir. Camille Froidevaux-Metterie conclut en disant qu’il s’agit de « permettre aux femmes de connaître ce que tous les individus sont en mesure d’éprouver, la joie du corps exultant, et d’affirmer la légitimité d’une capacité de jouissance dont seuls les hommes ont jusqu’à présent pu tirer les bénéfices, tant personnels que sociaux. Il s’agit d’en terminer avec des siècles de négation du désir et d’entraves à la jouissance des femmes, préalable au déni de leur créativité et au bannissement de leurs aspirations sociales. Et il s’agit de le faire non pas en clamant un quelconque droit au plaisir ni en inventant de nouvelles injonctions, mais en suivant ce précepte féministe de base qui consiste à accepter l’ouverture maximale des possibles en érigeant le consentement en pierre cardinale de la sexualité. » (p.260).
Il n’empêche que le corps féminin est celui qui porte les enfants et à ce titre la maternité a été la cage la plus efficace pour enfermer les femmes. C’est ce thème qu’aborde le chapitre 9 intitulé : « le corps procréateur ».
Il faut mesurer la libération apportée (aux femmes occidentales des classes favorisées) par la contraception chimique dans les années 1970. Cependant la maîtrise de leur procréation n’a pas immédiatement accordé aux femmes le statut d’individu moderne libre. Les discriminations et les violences persistent.
Hyper valorisée pour enfermer les futures mères dans la sphère privée, à l’inverse, la maternité a été présentée par S de Beauvoir en des termes glaçants que rappelle l’autrice : « la future mère forme avec cet enfant dont elle est gonflée un couple équivoque que la vie submerge ; prise aux rets de la nature elle est plante et bête, une réserve de colloïdes, une couveuse, un œuf » ; d’être humain « conscience et liberté », la femme enceinte est devenue un instrument passif de la vie » (p.262-263).
Il s’agit aujourd’hui de se réapproprier la maternité selon d’autres perspectives, à distance des attentes et des injonctions.
Les années 1970 ont donné aux femmes la liberté d’enfanter ou non, et cela a permis une redéfinition de la famille qui cesse d’être « l’institution sociale qui permettait au patriarcat de se perpétuer » (p.264). La parentalité devient désormais une option pour toutes et tous, aidée en cela par la PMA. L’autrice invite à penser un « corps relationnel » qui ne serait plus « défini par ses caractéristiques physiologiques ou biologiques mais en tant que vecteur premier et indépassable de la relation de parentalité qui s’établit lorsqu’un enfant arrive dans une famille » (p.273). C’est à partir de cette considération qu’elle développe une argumentation favorable à la GPA.
Dans le paragraphe consacré à « l’épreuve du réel maternel », l’autrice décrit à travers son vécu, à quel point la mal nommée « fausse couche » du premier trimestre peut être terriblement douloureuse. Dans le déni social qui l’accompagne, il faut traverser un « deuil sans rituel ni reconnaissance ». Il faut affronter en sus un incroyable sentiment d’échec : « la grossesse était fausse, je n’ai pas su la réaliser » (p.282). L’autrice a eu quatre grossesses et deux enfants ; mais qui compte les grossesses demande-t-elle ? Personne.
Concernant l’accouchement et la maternité, Camille Froidevaux-Metterie note que longtemps « les féministes se sont désintéressées de l’expérience vécue (…) longtemps il n’a plus été possible de penser l’engendrement dans une perspective féministe sous peine de subir un fort soupçon de différentialisme quasiment synonyme d’anti-féminisme » (p.292). Mais ces temps semblent révolus et désormais une nouvelle question se pose : « comment assumer l’aspiration à la non maternité ? » Et surtout, pourquoi devoir répondre et justifier ce choix ?
Il n’empêche que l’autrice invite à sortir la grossesse de sa gangue d’aliénation dans laquelle Simone de Beauvoir l’a enfermée dans l’esprit des féministes.
Le dernier chapitre du livre traite du « corps sous les regards ». Regard des hommes et regards des autres femmes. La compétition féminine est de tous les temps, pour souscrire aux critères patriarcaux d’un corps désirable. Et l’autrice est surprise de « l’intensification exponentielle des injonctions esthétiques et de la précocité de leur intériorisation » (p.311). Mais « ce n’est certainement pas en niant l’importance de ce souci esthétique, ni en stigmatisant celles qui l’éprouvent que l’on changera quoi que ce soit à la nécessité dans laquelle les femmes se trouvent de se représenter aux autres et au monde. » (p.313). L’impératif de se façonner pour s’embellir finit par rendre les femmes étrangères à leur être corporel, au point de se sentir toujours, insuffisantes, imparfaites… Simone de Beauvoir range le souci de l’apparence du côté de l’aliénation, mais n’est-il pas possible de concevoir un plaisir de se vêtir ? Un plaisir qui ne postulerait pas l’anticipation du regard de l’autre mais articulé selon d’autres critères. Iris Marion Young repère la satisfaction sensuelle du toucher que procurent les vêtements sur la peau. Elle évoque également le lien de sororité qui se noue entre les femmes à travers leurs vêtements, et enfin la « capacité de se fantasmer dans les tenues folles que propose la mode » (p.337).
Mais le corps sous les regards est aussi le corps qui vieillit. Là encore Simone de Beauvoir décrète qu’une femme ménopausée est condamnée à n’être plus rien puisque dépouillée de sa féminité, et : « il lui reste à vivre, privée de tout avenir, environ la moitié de sa vie d’adulte » (p.345). Et la même d’ajouter que « cela durera jusqu’au jour où elle consentira à vieillir et où, affranchie de ses chaînes, et déchargée de ses devoirs, elle découvre enfin la liberté ». Il y aurait donc une liberté au bout de la vieillesse ? Mais la lugubre aventure reprend pour la philosophe qui voit dans le vieillissement féminin à partir de la cinquantaine un programme de disqualification et d’invisibilisation (p.347). A ce stade, la femme change de statut et on parle dans toutes les langues de « retour d’âge ». Elle tombe « dans le registre de la déficience et de la dégénérescence » (p. 353) et doit intégrer toutes les représentations dépréciatives qui leur sont proposées et que tout contribue à leur renvoyer : la science, les miroirs… comme le constate Beauvoir dans La force des choses. L’autrice pense que la condition pour que les femmes puissent « basculer d’une appréhension angoissée et négative du tournant de la cinquantaine à une conception assumée et positive, c’est que la parole féminine se répande et que les expériences se partagent. » (p363). En effet, elle a repéré à juste titre que si les mères parlent à leurs filles jeunes des règles qu’elles auront, plus rien ne sera échangé avec leurs filles adultes, sur la période où elles vont disparaître. Et elle constate avec le psychanalyste Sylvain Mimoun que « les hommes font comme s’ils avaient le temps et que le temps avait moins de prise sur eux. Leurs références temporelles sont extérieures à leur corps. » (p.365).
La conclusion rappelle ce qui a été décrit, à savoir que l’expérience des femmes est vécue selon les scansions d’un temps linéaire qui ramène sans cesse à la contingence, à la variabilité de la condition humaine. Il s’agit de réinvestir le corps féminin afin de « l’extirper de sa gangue d’aliénation ». Et pour cela le féminisme doit s’adresser aux hommes pour les placer devant leurs responsabilités. Ce n’est pas qu’une affaire de femmes. Il faut revenir de la misandrie des premiers moments, même si la colère des femmes est légitime face au patriarcat et à ses scandales. La misandrie pour l’autrice est le moteur originel et nécessaire de la libération des femmes mais elle n’est pas synonyme de guerre des sexes. « Elle implique que les hommes opèrent leur mue féministe, ce qui suppose d’abord qu’ils acceptent la misandrie pour ce qu’elle est ; la désignation claire et frontale des responsables de la reproduction patriarcale dans nos sociétés » (p.374). L’autrice invite alors à « un enrôlement des hommes dans le projet de transformation féministe du monde » qui en finirait avec « la conception hiérarchiquement sexuée du corps, surdéterminant et aliénant quand il est féminin, neutre et valorisant quand il est masculin (p.376).
[1] Manon Garcia, On ne naît pas soumise, on le devient, Paris, Climats, 2018.
[2] Élisabeth Badinter, « la reine-mère », in Les temps modernes 647-648, 2008, p. 158, cité p.84.
[3] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, T.2, L’expérience vécue, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1976, p.591.
[4] Camille Froidevaux-Metterie, Un corps à soi, Paris, Seuil, 2021, 382p., p 165.
[5] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, T.1, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1976, p.280 et 285