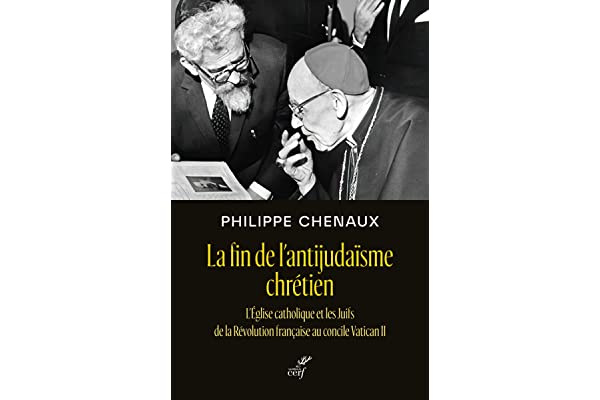Vient de paraître aux éditions du Cerf le livre de Philippe Chenaux, La fin de l’antijudaïsme chrétien. L’Église catholique et les Juifs de la Révolution française au concile Vatican II, Paris, Éditions du Cerf, 2023.
Voici l’analyse de cet ouvrage proposée par Sylvaine Landrivon
Cet ouvrage présente un remarquable caractère didactique qu’il convient de saluer avant tout autre commentaire. En termes simples, avec une approche factuelle et concise, Philippe Chenaux reprend la relation de l’Europe face au judaïsme, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la période qui succède au second concile du Vatican.
En 7 parties l’auteur développe, de façon globalement chronologique, les méandres de la confrontation du christianisme européen avec l’antijudaïsme puis l’antisémitisme. Il montre comment l’Église est très lentement revenue sur un antijudaïsme pluriséculaire. L’ouverture récente des archives de Pie XII a mis en lumière l’ambigüité de l’institution catholique que des militants comme Maritain, Béa, et autres Édith Stein et Jules Isaac ont dénoncée à longueur d’années.
Si l’avant-propos, plein d’optimisme, affirme que l’Église catholique a désormais tourné la page de l’antijudaïsme, il admet que, comme l’écrivait Walter Kasper en 2002, « Nostra aetate est loin d’être un programme terminé ». Le livre va mettre en évidence que l’on ne corrige pas toujours avec succès toute la judéophobie accumulée au fil des siècles.
Le prologue traverse brièvement les époques que l’ouvrage n’aborde pas et rappelle que l’antijudaïsme est aussi vieux que l’Église. Les premiers Pères n’avaient d’autres propositions qu’une conversion sans laquelle les Juifs subissaient discriminations et persécutions et le livre va montrer que cette tendance aura la vie très longue, puisque ce sera encore la position de l’Eglise Catholique jusqu’au deuxième concile du Vatican. Dans ce domaine, le concile de Latran IV en 1215 détient un sommet, en voulant « protéger les chrétiens de la perfidie juive » et en imposant (déjà !) le port d’un signe distinctif sur les vêtements.
La première partie de l’ouvrage traverse l’histoire depuis les Lumières jusqu’à la Restauration. On apprend que c’est d’Allemagne que vient l’idée d’émancipation. L’abbé Henri Grégoire en sera l’emblème en France grâce à sa Motion en faveur des Juifs présentée à l’Assemblée Nationale le 03 août 1789. Mais les catholiques éclairés qui accueillent cette émancipation sont peu nombreux, et dès la chute de Napoléon, « les juifs retrouvèrent, dans la plupart des pays européens, leur condition d’exclus » (p.33). Le pontificat de Léon XII va durcir le statut des juifs, et au fil des années, en Italie d’abord, le soutien papal va favoriser « le développement d’une littérature antijuive très polémique » (p.36). Comme la conversion est l’unique voie proposée, tous les efforts vont se porter dans ce sens durant le XIXe siècle. La congrégation Notre-Dame de Sion dédiée d’abord à Marie-fille d’Israël, est fondée par les frères Ratisbonne pour convertir les Juifs au christianisme va devenir de plus en plus prosélyte, avant d’enfin revenir à sa mission première et : « l’éradication de l’anti-judaïsme chrétien devint l’un de [ses] objectifs prioritaires » (p.46).
Dans cette fin de siècle, l’auteur note l’implication des frères Lémann et leur souci d’en finir avec les « préjugés antichrétiens attachés à la pratique de leur religion » (p.49). Il souligne comment leur héritage s’est prolongé au sein des facultés catholiques de Lyon, au point que c’est de cette ville « que devaient s’élever quelques-unes des plus fortes voix chrétiennes contre l’antisémitisme nazi. » (p.49).
Mais auparavant, la fin du XIXe siècle, aura manifesté un retour en arrière dans lequel la haine antijuive bascule. « Le glissement de l’antijudaïsme religieux à l’antisémitisme racial s’est fait progressivement et pour ainsi dire naturellement dans les milieux catholiques intransigeants » (p. 53). Le politique va se joindre à la religion, et dans toute l’Europe, comme l’écrit l’historien italien R. Moro, le juif « moderne » remplace le juif « pieux » qui apparaît comme « encore plus dangereux parce qu’assimilé et, surtout, sécularisé et laïcisé » (p.57). L’antisémitisme politique est alors prôné en Italie comme la seule réponse possible pour défendre la civilisation chrétienne. La France n’est pas épargnée : « principal vecteur de l’antisémitisme, côté catholique, fut le journal La Croix fondé par les Assomptionnistes » (p.62). Pendant ce temps, se déroule « l’affaire Dreyfus », vis-à-vis de laquelle le Vatican reste d’une grande prudence.
L’auteur met en évidence les racines socio-économiques de cet antisémitisme galopant, et, en Autriche, K. Lueger se fait élire à Vienne pour « combattre l’horreur du capitalisme et du matérialisme athée dont les juifs apparaissent comme les principaux agents » (p.71). C’est cependant sans compter sur l’empereur François-Joseph qui refuse de ratifier cette élection affirmant que « l’antisémitisme est une maladie qui se répand de manière insolite et pénètre les cercles les plus élevés » (p. 75). Mais un autre Autrichien fera hélas, lui, l’apologie de Lueger dans Mein Kampf…
La troisième partie du livre fait l’éloge du philosémitisme catholique qui s’exprime dans l’entre-deux-guerres. Durant cette période, se crée très brièvement à Rome « l’Association des Amis d’Israël, dans le but de promouvoir une attitude nouvelle basée sur la charité et l’estime, à l’égard des juifs. » (p.79). La « question juive » semble enfin se replacer dans une perspective religieuse. Mais l’association sera dissoute deux ans après sa naissance pour avoir osé demander « que l’on modifiât la grande prière d’intercession du Vendredi saint en corrigeant l’épithète offensante Oremus et pro perfidis Iudaeis » (p.95)
Avec le début du XXe siècle, les préoccupations s’entremêlent : le bolchévisme, le sionisme… Le Saint-Siège demeure ambivalent, et distingue alors « deux formes d’antisémitisme, l’une de type racial et antichrétien, formellement prohibée, l’autre, de nature politique et juridique, permise, sinon encouragée » (p.99).
Ainsi, quand Théodore Herzl demande le soutien de Rome pour son projet, il lui est répondu que l’on « ne peut pas encourager le retour d’Israël sur la terre de Jésus » (p.84).
Pendant que les intellectuels français à l’instar de J. Maritain, vantent les conversions de juifs au catholicisme, les exégètes redécouvrent les racines juives du christianisme. J. Bonsirven publie un « Bulletin du judaïsme ancien » dans la revue Recherches de science religieuse et rédige plusieurs ouvrages pour réhabiliter la religion juive étudiée pour « elle-même ». De son côté, Augustin Béa, futur père de la déclaration Nostra Aetata, dénonce l’antisémitisme et rappelle qu’il est « blasphématoire d’opposer le Dieu de l’Ancien et le Dieu du Nouveau Testament » (p.105-106). On semble devoir renoncer à l’antisémitisme religieux mais c’est pour mieux laisser libre cours à l’antisémitisme d’état soutenu par l’Église.
C’est ce que développe la quatrième partie. Dès 1933 Édith Stein écrit au pape Pie XI et lui demande de condamner la doctrine nazie, raciste, totalitaire, antisémite. D’autres alertes suivront mais elles ne déboucheront « sur aucun document explicite en dépit de la volonté de Pie XI d’aller dans ce sens dans les derniers mois de son règne » (p.114).
Philippe Chenaux aborde ensuite l’Allemagne nazie et dans l’Italie fasciste. Le Vatican va mettre dans la même condamnation le nazisme et le communisme. Deux grandes encycliques seront publiées mais celle sur le nazisme ne dit rien de l’antisémitisme.
Pendant ce temps dans la France de Vichy, quelques rares voix s’élèvent pour lutter contre l’horreur antisémite. Oscar de Férenzy fonde La juste Parole ; Jacques Maritain se démène et dans ce qu’il nomme une « erreur de l’esprit », note « l’impossibilité de l’antisémitisme pour un chrétien ». Dans un grand texte de 1937, il récuse « toute définition du peuple juif en termes de ʺraceʺ, de ʺnationʺ, ou même de ʺpeupleʺ : ʺIsraël est un mystère du même ordre que le mystère du monde et le mystère de l’Égliseʺ » (p.141).
Pie XII est supplié d’intervenir pour lutter contre l’antisémitisme. Des théologiens comme Joseph Chaine, Henri de Lubac… interviennent pour une meilleure connaissance du peuple d’Israël et montrent qu’en cas de victoire adverse « c’est notre foi elle-même qui serait détruite en ses fondements » (p.149). Mais « rares furent les évêques français à avoir le courage d’élever une voix prophétique au lendemain de la rafle du Vélodrome d’hiver des 16 et 17 juillet 1942 » (p.149).
La cinquième partie est consacrée au Vatican de Pie XII et à la solution finale. Faut-il accepter l’hypothèse selon laquelle le Vatican n’aurait alors pas pris pleinement conscience de l’ampleur de la tragédie vécue par le peuple juif ? Il faut peut-être plutôt entrevoir que l’institution catholique a préféré ne pas voir, et s’est consacrée à un autre de ses soucis, ce qui fait écrire à l’auteur : « L’impératif de défendre la civilisation occidentale devant le péril communiste (…) imposait à l’évidence d’autres priorités » (p.186).
Jules Isaac dénonce le « pharisaïsme chrétien » d’un Daniel-Rops qui a conduit trop de gens jusqu’à Auschwitz. Le grand rabbin Jacob Kaplan le rejoint en notant que « tant qu’on aurait pas réussi à corriger cet ʺenseignement du méprisʺ, on ne parviendrait pas à extirper le fléau de l’antisémitisme. » (p.191).
Après la Shoah, il faut aborder les destinées d’Israël et intervient la conférence de Seelisberg en 1947 qui réunit 19 pays et où le Saint-Siège, non représenté, reçoit les échos par Jacques Maritain. Comme base : un mémorandum en 18 points préparé par Jules Isaac et intitulé : « De l’antisémitisme chrétien et des moyens d’y remédier par un redressement de l’enseignement chrétien ». Il était notamment question « de ʺrappelerʺ l’unicité de la parole de Dieu dans l’Ancien et le Nouveau Testament » (p.209). Long travail qui aboutira à des recommandations en dix points qui devinrent « la charte de l’Amitié judéo-chrétienne de France fondée à Paris en mai 1948 par Jules Isaac et Edmond Fleg » (p.215), mais ce courant demeure isolé au sein du monde catholique.
L’auteur illustre cette pénible période par la terrible affaire Finaly, du nom de deux enfants juifs recueillis par une femme Grenobloise qui refusa de rendre les enfants à leur famille et poussa le zèle jusqu’à les faire baptiser en 1948 (!!!). L’Eglise a longuement tergiversé sur ce sujet et le représentant du Saint-Siège en 1946 concluait que « tous les enfants seraient rendus à leurs parents, sauf s’ils avaient été baptisés » (p.222). On souffre de grande honte à reproduire ces lignes aujourd’hui… Mais il faudra encore des humiliations, des souffrances et du temps, avant de s’acheminer vers la suppression du « pro perfidis iudaeis » dans la liturgie du Vendredi saint, qui révèle ad nauseam, la faute catholique.
Nostra aetate, la déclaration conciliaire sur les religions non chrétiennes sera adoptée en octobre 1965. Elle marque un tournant qu’on espère décisif. Un lent processus de compréhension conduira à la visite de Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 1986 où on entendra enfin ces mots : « Vous êtes nos frères préférés et, d’une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés » et le Catéchisme de l’Église catholique en 1993 reconnaitra, -enfin,- « au peuple de Dieu une identité, non pas d’abord nationale ou ethnique, mais proprement ʺecclésialeʺ, donc surnaturelle, comme peuple de Dieu » (p.265).
Au terme, le livre met clairement en évidence l’attitude ambivalente de la papauté cherchant « d’une part [à] protéger le peuple juif, en tant que peuple-témoin de la révélation, contre les violences des chrétiens, de l’autre [à] protéger ces mêmes chrétiens contre l’influence néfaste de ce dernier à travers des mesures de discrimination et de ségrégation » (p.269). Pour l’Institution Romaine, « symbole de la modernité honnie, les juifs en raison de la ʺperfidieʺ attachée à leur race à cause de leur infidélité à la première Alliance, demeuraient inassimilables », ce qui fait qu’avant le concile de Vatican II, il n’a jamais été prononcé de condamnation claire de l’antisémitisme.
L’ouverture des archives du pontificat de Pie XII, confirme la « prégnance de cette mentalité antijuive, de nature pour ainsi dire ʺthéologiqueʺ » qui a « représenté un obstacle à la prise de conscience de l’immensité du drame de la Shoah. » (p.271). Puisse un tel livre nous permettre de réfléchir au processus abominable auquel conduisent des constructions mentales erronées, dissimulées dans des arguments spécieux…