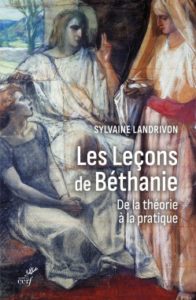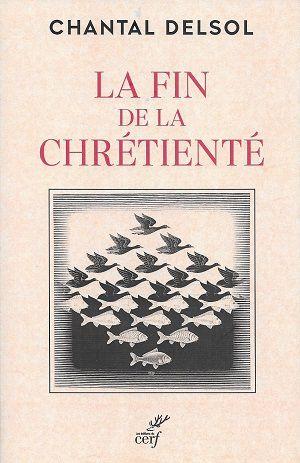Regard sur Chantal Delsol, La fin de la chrétienté. L’inversion normative et le nouvel âge, Paris, Les Éditions du Cerf, 2021, 172p., par Sylvaine Landrivon
La vigilance s’aiguise quand, dès le titre, l’enjeu se focalise sur un mot : il ne sera pas question dans ce livre de christianisme, ni même de catholicisme, mais de ce qui se cache sous le terme « chrétienté ». Et l’autrice va montrer qu’il s’agit de bien autre chose qu’un message à transmettre. Elle évoque une civilisation qui a utilisé un courant comme support à sa propre hégémonie et Chantal Delsol observe et décrit, impuissante, un inéluctable déclin.
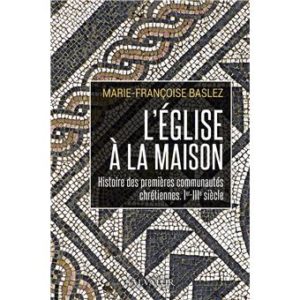 C’est pourquoi, l’important est alors de ne pas s’embrouiller dans l’ordre des lectures : il faut d’abord avoir pénétré la pensée de Marie-Françoise Baslez dans l’Église à la maison e
C’est pourquoi, l’important est alors de ne pas s’embrouiller dans l’ordre des lectures : il faut d’abord avoir pénétré la pensée de Marie-Françoise Baslez dans l’Église à la maison e t celle de Michel Quesnel dans Paul et les femmes.
t celle de Michel Quesnel dans Paul et les femmes.
L’un et l’autre exposent les débuts du Christianisme et la façon dont il s’est fait absorber et détruire par l’élaboration d’un système de domination sociétal. Dès lors, bien sûr que oui, nous adhérons avec enthousiasme à l’analyse de Chantal Delsol et constatons avec elle La fin de la Chrétienté.
Après deux ou trois siècles de tentatives de mise en application des propositions « révolutionnaires » suggérées par les apôtres, le pouvoir humain s’est emparé des préceptes chrétiens et a fondé son emprise sur la plupart des peuples d’Occident. « On date généralement du règne de Constantin (272-337) l’amorce de la Chrétienté » (p.47), que l’autrice situe plus précisément au temps de Théodose. Cette Chrétienté, née à la fin du IVe siècle, va, en effet, substituer au message de l’Évangile, les Dogmes édictés par l’institution cléricale. Cette chrétienté autoritaire imposera ses lois au prix de guerres, de bûchers, de falsifications et de mauvaises interprétations, telles le dévoiement de « hors de l’Église, point de salut ». Aujourd’hui, elle s’essouffle, enfin. L’autrice pense que sa mort est prochaine. Mais pour quelqu’un avide de voir advenir les préceptes du Nouveau Testament, ne sont-ce pas des Alleluia, qu’il convient d’entonner, tant la forme autrement dit cette « Chrétienté », a trahi le fond, c’est-à-dire le Christianisme ?
A aucun moment dans les 172 pages du livre, il n’est fait référence au Christ, pas davantage à l’Évangile. Le sujet de cet essai n’est pas dans ce qu’il advient de la transmission du message d’amour et de salut que Jésus est venu révéler, mais dans la manière dont s’est imposée l’institution catholique. D’une inversion normative des lois romaines à une ré-inversion contemporaine, Chantal Delsol étudie ce qui s’est produit avec une honnêteté et une lucidité qui impressionnent.
Il faut rendre hommage à sa rigueur : dans les cinq chapitres qui composent le livre, l’autrice confond rarement le christianisme, qui l’intéresse assez peu, et la chrétienté, objet de son ouvrage. Dès la première page elle note que l’Eglise demeure éternelle pour les catholiques mais non la chrétienté (qu’elle mentionne avec un C majuscule). Et de citer Emmanuel Mounier : « le christianisme est une alternative au fond du cœur, et pas un établissement » ; ce qui montre qu’elle adhère avec nous à l’idée selon laquelle le Christianisme se fonde sur l’Évangile alors que la chrétienté n’est qu’une institution. C’est pourquoi ce qui ressemble à une déploration, à une « marche à l’abîme », une « chute » où « tout se [défait] », tandis que « d’autres religions ont envahi la scène », se conclut sur une note qui, certes, exclut les mouvements auxquels elle adhère, comme la Manif-pour-tous, mais qui remplit d’espoir les croyants progressistes qui veulent « En finir avec le cléricalisme » selon le titre du livre de Loïc de Kérimel.
Dans son approche des causes du déclin de l’institution, elle remarque que les révolutions qui se sont produites dans des pays protestants ont adopté aisément les idées nouvelles alors que la France a vécu un choc frontal entre les valeurs du Magistère romain et celles des Lumières. Ne serait-ce pas justement parce que les premières –les révolutions néerlandaise, anglaise ou américaine-, se référaient à l’Évangile quand les pays catholiques l’avaient troqué contre le Dogme ? Se trompant pour une fois de cible, l’autrice croit voir dans le Christianisme, l’apologie de « la hiérarchie, l’autorité et la contrainte » (p.17) et rappelle les efforts du pape Pie IX contre la modernité dans les 80 articles de son Syllabus. Les années 60 du XXe siècle sont pour elle un tournant « pendant lesquelles tout allait se défaire » (p.32), entraînant « une protestantisation d’une partie du catholicisme » (p.30). Le refus des valeurs Maurassiennes, les acquis du Concile Vatican II, créent un « paradoxe intérieur ». Chantal Delsol constate que tout ce maillage profond, « cette autorité, et même cette domination sur les lois et les mœurs », et qu’elle appelle la Chrétienté, se défait. Tout se détricote à partir de ce moment. Face aux protestants et aux juifs qui sont individualistes, « les chrétiens (sic !) (…) sont universalistes » (p.37) et alors que leur doctrine leur interdit de se saisir d’un pouvoir terrestre, ils sont assignés à un poste « de surveillance, de veille, d’inspection, et de contrôle » (p.37). Mais assignés par qui, puisque précisément l’Évangile conteste cette emprise sur le monde ?
Et de constater des changements profonds : « Dans le monde de nos pères, la colonisation était généreuse et admirable, la torture et la guerre des pis-aller ; aujourd’hui la colonisation et la torture sont des gestes sataniques (…) L’homosexualité était bannie et méprisée, elle est aujourd’hui non seulement justifiée mais vantée. (…) La pédophilie, considérée auparavant comme un pis-aller qu’on supportait pour la sauvegarde des familles et des institutions, est aujourd’hui criminalisée…. » (p. 43). L’autrice nomme ce changement de modèle une « inversion normative » et assure qu’elle « affole une partie des chrétiens, d’où les Manifs-pour-tous ou les associations pro-vie » (p.46), ce qui « traduit et raconte la fin de la Chrétienté ».
L’inversion normative entre Rome et la Chrétienté puis entre la Chrétienté et le monde occidental contemporain sont alors analysées.
Passons sur la contradiction qui, dans la même page 51, fait écrire à Chantal Delsol que « Nombre de valeurs romaines sont reprises, à ce point que les Romains de tradition accusent les chrétiens de parasitisme », pour dire au paragraphe suivant que « l’univers des chrétiens était l’envers de celui des Romains. » Pour elle, les Romains, acceptent le divorce, l’homosexualité, l’avortement, l’infanticide, le suicide… La Chrétienté les contredit sur tous ces points.
Aujourd’hui « l’inversion normative (…) représente presque exactement le contraire de ce qui se passa au IVe siècle. Et pour ainsi dire, l’inversion de l’inversion. On rétablit le divorce que la Chrétienté avait aboli. On permet l’infanticide que les chrétiens avaient interdit (…) On pare de légitimité l’homosexualité ou le suicide, que l’Église naissante avait criminalisés » (p.65). « On récuse donc la pédophilie qui nuit à l’enfant, mais pas l’IVG, qui s’attaque à un être inconscient » (p.64) après avoir cependant reconnu quelques pages auparavant que l’avortement : « est un meurtre pour les chrétiens après 40 jours » (p.54). Elle notera également en fin d’ouvrage que les femmes n’ont pas réclamé l’IVG par esprit de débauche mais « parce qu’elles ne croyaient plus que l’enfant était un ambassadeur de Dieu » (p.155). Peut-être l’est-il, en effet, à l’instar de tout migrant qu’on laisse mourir dans les eaux de la Méditerranée, mais à quel stade de sa constitution ; embryonnaire, fœtal ?…
Et l’autrice de se demander : « pourquoi une partie des chrétiens, et dans certains pays la presque totalité, ont-ils commencé à juger les commandements de l’Église inacceptables » (p.69) ? Peut-être parce que certains d’entre eux se sont éloignés de l’Evangile jusqu’à le contredire ?
Comme le montre ces illustrations, Chantal Delsol pleure l’ancien ordre moral dicté par l’Église et pointe d’étranges « victimes affolées » (p.70). Parmi celles-ci : « le grand-père incestueux qui avait toujours considéré sa pratique comme une sorte de droit de cuissage, et se voit tout à coup désigné comme un criminel monstrueux. » (p.71), ou un peu plus loin : « Les cas d’actes pédophile (…) existaient (…) C’était l’usage de couvrir ce genre de comportements, afin de ménager l’institution. (…) Il est extraordinaire de voir tout à coup accuser de crime des gens qui se voyaient au moment des faits, et selon l’usage, coupables d’un petit écart. » (p. 71).
On croit avoir mal lu ce qui ressortit à une banalisation de l’inceste, du viol… Le texte a le mérite de l’honnêteté dans sa relativisation qui exonère les coupables et vise à minorer ces actes dans la hiérarchie institutionnelle. Chantal Delsol sait et confirme que tout le monde connaissait l’existence de ces faits et que « c’était l’usage de couvrir ce genre de choses » (p.72), l’Église privilégiant toujours l’institution par rapport à l’individu (p.73). On aurait envie de lui demander si, selon elle, au regard du Christ et non de la Chrétienté qu’elle évoque, violer un enfant est ou non un crime. Et s’il est tellement fâcheux que « l’individu à présent passe avant l’institution » (p.73).
Après l’inversion normative, l’autrice aborde « l’inversion ontologique » et revient pour cela à ce qu’elle pointe comme le début de la chrétienté. Sans surprise à ce moment du livre, le lecteur note l’identification de ce commencement à l’époque des premiers conciles. Pas aux premiers témoignages apostoliques, où on admettait avec Paul dans sa Lettre aux Galates qu’ « il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus. » (Ga,3,28) – le Nouveau Testament n’est jamais cité dans ce livre-. D’ailleurs pour Chantal Delsol, « les choix ontologiques ne tombent jamais du firmament : ce sont des décisions humaines, des engagements contractés ensemble. » (p.82). Dans cette inversion ou dérive ontologique, elle entrevoit « de nouvelles appétences pour les religions orientales » (p.91). Selon elle, « les offres religieuses asiatiques correspondent aux aspirations contemporaines. Elles ne sont pas attachées à la notion de vérité » (p.94). Mais le plus grand danger vient peut-être de l’écologie dans laquelle elle perçoit « une forme de cosmothéisme lié à la défense de la nature » (p.99). Sa charge contre cette forme de « paganisme » est sévère. Elle oppose le monothéisme dans lequel « ce monde n’est qu’un séjour » au cosmothéisme pour qui il est une demeure… Elle dénonce l’écologie comme étant une religion, une croyance qui « produisent des convictions et des certitudes irrationnelles » (p.103) et elle redoute que la nature redevienne l’objet d’un culte : « nos contemporains (…) embrassent les arbres » et craint l’approche d’un « panthéisme qui traduit la défense de l’environnement en religion » (p.106). Dans ce « tout fout le camp », elle note : « Aujourd’hui, on voit des institutions catholiques vouer une dévotion à l’Art Contemporain (…) ou bien au culte de Gaïa, forme de cosmothéisme postmoderne » (p. 148).
Elle conclut ce chapitre en pointant l’affolement chrétien devant une morale qui disparait avec l’effacement du monothéisme. Dans les mondes polythéistes la morale venait de la société ; « c’est l’État qui est gardien de la morale » (p.106). On hésite à demander : et pendant les 16 siècles de domination catholique, c’était qui ?…
Quelques références étranges à Dietrich Bonhoeffer ou Simone Weil parsèment le livre sans que le lecteur comprenne comment intervient leur référence dans le discours. C’est le cas page 140 et dans la conclusion, où des remarques semblent venir a contrario de la thèse soutenue par ailleurs.
L’hypothèse d’un christianisme sans chrétienté n’est cependant pas ignorée. Et le dernier chapitre pose la question : « Que devient, que va devenir l’Église sans la Chrétienté ? » (p.145).
L’autrice a perçu chez les clercs, des réactions de résignation, de renonciation. Elle admet qu’en possession du pouvoir, on peut redéfinir l’histoire et qu’aujourd’hui, « privée de pouvoir, l’institution assume tout son passé » (p.146) au point de voir chez les clercs un empressement « à tomber dans cette mauvaise conscience pestilentielle », comme s’il ne fallait pas regretter les bûchers de l’Inquisition et les guerres de religion. Le mea culpa d’une partie de l’institution la dérange. « L’inversion normative exhibe d’anciennes victimes vengeresses et furieuses, mais elle exhibe aussi d’anciens oppresseurs tourmentés (…) au point que le clan de ceux qui défendent et revendiquent ouvertement l’ancien ordre des choses, ceux de la « manif-pour-tous », par exemple, sont ostracisés par l’institution ecclésiale qui les rejette de ses instances » (p.147).
Pour Chantal Delsol, « la conquête n’est plus de mise » (p.153) et constate enfin que « l’Église privée de son pouvoir temporel et civilisationnel ne sera pas pour autant empêchée de vivre ». Citant le protestant Jacques Ellul, elle remarque que l’institutionnalisation tue le message et se demande au terme si : « la fin de la Chrétienté n’est-elle pas plutôt un bienfait qu’une catastrophe ? » (p.158). Mais contrairement à ce qu’elle écrit ensuite ce n’est pas « le christianisme [qui] s’est aboli par sa propagation » (p.159) c’est le pouvoir de l’institution catholique qui périclite, et ceux qu’elle assimile aux « soldats de Waterloo », ne voient pas assez venir celles et ceux pour qui le message de Jésus-Christ va enfin pouvoir retrouver le cours qu’il a dû abandonner à la fin des tout premiers siècles, au temps où autour de Paul, femmes et hommes collaboraient à sa transmission. L’autrice le perçoit pourtant très clairement : « cette situation inédite dans notre histoire, finalement nous ramène à l’âge des premiers chrétiens » (p.163) et elle cite à juste titre Jacques Maritain, en cette fin d’analyse : « Le retour des masses en chrétienté ne s’accomplira que par l’amour, je dis l’amour plus fort que la mort, le feu de l’Évangile ». Comme elle l’observe aussi : « la difficulté pour le personnel de l’Église est d’accepter la perte de pouvoir » (p.163).
Au terme, un constat s’impose, la chrétienté meurt ; la toute puissance de l’institution catholique romaine s’éteint ; peut-être pour que renaisse enfin le christianisme enseigné par Jésus à ses apôtres : Marie la Magdaléenne, Pierre, Paul, Marthe, … mais est-ce le souhait de l’autrice que de voir revenir les valeurs transgressives d’amour et de fraternité/sororité proposées par le Christ ?
La suite se trouve peut-être dans Les leçons de Béthanie. ? 🙂