 Dans le cadre des conférences du mercredi organisées au Café Simone par les “AlterCathos” de Lyon, Sabine Adrien recevait Sylvaine Landrivon pour évoquer le thème des femmes dans la Bible
Dans le cadre des conférences du mercredi organisées au Café Simone par les “AlterCathos” de Lyon, Sabine Adrien recevait Sylvaine Landrivon pour évoquer le thème des femmes dans la Bible
Un reportage vidéo sera disponible sur la chaîne youtube de cette association.
Voici ci-dessous le texte de la conférence.
La théologie a connu un véritable réveil au XXe siècle, rendu visible par l’apport du concile Vatican II. Sa constitution Gaudium et spes a notamment dénoncé comme devant être dépassée et éliminée « toute forme de discrimination (…) qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, [car] contraire au dessein de Dieu [1] ». Avec sa constitution Dei Verbum, ce concile nous a aussi invités à lire et relire la Bible.
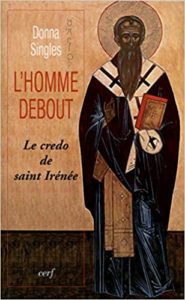 Dans cette dynamique, des Lyonnaises comme Marie-Jeanne Bérère, Renée Dufourt se sont mobilisées et ont espéré dans les années 70. Avec Donna Singles, sœur de saint-Joseph venue des USA étudier Saint-Irénée, elles ont créé un centre d’études du féminisme et ont porté des valeurs de propositions fortes.
Dans cette dynamique, des Lyonnaises comme Marie-Jeanne Bérère, Renée Dufourt se sont mobilisées et ont espéré dans les années 70. Avec Donna Singles, sœur de saint-Joseph venue des USA étudier Saint-Irénée, elles ont créé un centre d’études du féminisme et ont porté des valeurs de propositions fortes. 
Au début des années 2000, le centre de recherche qu’elles avaient créé a été dissout, et la contribution des femmes au renouveau de noter Église végète. Pourtant nous publions, et tout récemment encore Anne-Marie Pelletier expliquait que les fondements du christianisme dévoilent une Église réellement constituée de « femmes avec des hommes[2] » (selon le titre de son dernier ouvrage). Mais l’institution, au lieu de choisir d’enrichir son enseignement et sa gouvernance de ces apports féminins majeurs, préfère demeurer dans l’entre-soi clérical masculin dont les dérives sont hélas aujourd’hui connues de tous.
Il faut alors revoir, à nouveaux frais, comment la Bible ne manque pas de modèles féminins pour indiquer le chemin de la divinisation et en témoigner.
Nous n’aborderons pas aujourd’hui Ève, qui initie le dialogue humain, ni les matriarches (Sarah, Rebecca, Rachel et Léa), et très peu Marie dont le sublime « oui » n’est pas signe de soumission mais d’audace. Mais rien qu’à les nommer, nous repérons que l’Écriture est jalonnée de femmes fortes qui acceptent de remettre en cause les règles du système en place, au profit d’un Bien supérieur qui n’apparaît pas toujours d’emblée à leurs partenaires masculins.
De récit en récit, dans chaque situation de crise où il est question de pointer l’altérité, ou bien lorsqu’une prise de distance s’impose dans l’immédiateté du réel, c’est souvent une femme qui intervient pour récuser tous les préjugés de l’ordre établi, et réunir la foi et la raison. Restituant alors le sens de l’Alliance, son intervention contribue alors à la sauver.
Pour évoquer ces femmes, nous nous centrerons sur deux ou trois figures en commençant par celle qui nous est plus familière par les peintures du Caravage, d’Artémisia Gentileschi ou de Klimt que par sa présence dans nos célébrations.
Il s’agit de Judith dont la tradition a, hélas, moins transmis le courage et l’intelligence -mis au service de la survie de son peuple-, qu’un geste de funeste séduction.
 Judith : un portrait trompeur[3]
Judith : un portrait trompeur[3]
Le récit biblique qui lui est consacré (un livre entier !) est peu lu puisque plusieurs traditions ne le reconnaissent que comme apocryphe. Et cependant, les versets des seize chapitres qui le composent, nous livrent une vérité susceptible d’éclairer les relations entre hommes et femmes et ce faisant, notre manière de vivre en Église aujourd’hui.
Que dit le texte ? La ville de Béthulie est assiégée ; les soldats vont se rendre, et les prêtres ont renoncé à attendre l’aide de Dieu. Nabuchodonosor va se faire proclamer dieu lui-même et détruire toute trace de la foi dans le Dieu Unique. C’est dans ce contexte que Judith – une belle et jeune veuve- va se lever et proposer d’intervenir. Sur la plupart des tableaux qui lui sont consacrés, notre héroïne tient d’une main le glaive subtilisé à son ennemi Holopherne, de l’autre sa tête tranchée. Libre à l’observateur de traduire comment le pouvoir de sa séduction a vaincu. Nous sommes, en effet, en présence d’une femme qui assume sa féminité et l’utilise pour sauver son peuple et donner la victoire à son Dieu.
N’y aurait-il donc pas là quelque chose de subversif, voire d’un peu « sulfureux »? 
Le caractère subversif de Judith réside déjà dans son étrange situation de femme qui assume un célibat contraire à toutes les traditions de son peuple. Veuve, elle ne respecte pas la loi du lévirat et ne s’y conformera jamais. C’est donc en femme libre, autonome, habituée à gérer ses affaires, qu’elle se présente face aux chefs de Béthulie qu’elle « convoque », pour leur tenir un langage dénué de toute ambiguïté. Certains nommeront un jour « virago » ces femmes refusant toute tutelle masculine et l’appliqueront par prédilection à Judith. L’étymologie du terme est éloquente : puisqu’il s’agit d’une femme présentant de grandes qualités d’indépendance et de courage, on impute au mâle : vir des talents que leur présence en ces femmes, vient précisément contredire. Et pour leur ôter encore un peu de leur féminité suspecte, on les décrit vierges, ce qui n’est évidemment pas le cas de Judith.
Mais Judith ne saurait être suspecte aux yeux de ses congénères car elle sait n’être qu’un outil entre les mains de Dieu : « Donne à ma main de veuve la force que j’ai méditée » (Jdt 9.9). En effet, derrière la main de cette femme se cache l’agir de Dieu qui va se manifester à chacune des trois étapes clés de son entreprise.
Le texte biblique insiste d’abord sur le choix spécifique d’une femme, et le réaffirme pendant et après l’exécution du plan : « Le Seigneur souverain les a contrés par la main d’une femme. » (Jdt 16.5).
Il n’y a donc aucune ambiguïté quant à l’auteur de la victoire : c’est bien une intervention divine passant par la main d’une femme. Mais tout ce qu’elle entreprend devient troublant en s’exprimant à double sens.
Elle n’est plus vierge mais possède le statut d’épouse, sans mari et sans descendance.
Elle est pieuse sans respecter les coutumes du veuvage.
Elle se présente libre devant le conseil des anciens, humble, mais assez autoritaire pour prendre la direction d’une opération dont dépend la survie de son peuple ; sainte enfin qui vit dans le souvenir fidèle de son mari mais elle n’hésite pas un instant à séduire puis à trancher la tête de l’oppresseur et à la rapporter sans faillir pour l’exhiber devant les yeux horrifiés de la population.
Son expertise est encore plus prégnante dans son art du double langage qui nous est décrit comme un modèle de finesse et d’intelligence et qui mérite d’être savouré dans tout le texte.
Il faut finalement comprendre que Judith fait signe vers la puissance de Dieu logée au cœur de la faiblesse. Ainsi, de la force de Judith, il devrait nous rester non pas l’image d’une femme séductrice, mais le modèle d’une croyante exemplaire qui, contrairement à ses contemporains, ne s’effraye de rien, tant sa foi l’aide à maîtriser ses actes.
Paul Beauchamp a bien noté le caractère très relatif de la « faiblesse féminine » et s’en explique dans sa galerie de portraits bibliques, lors de son étude d’Esther et de Judith. Il met en évidence que dans ces deux histoires, le salut vient d’une femme, mais cela ne signifie pas pour lui qu’il vienne à travers la fragilité ! « Le salut jaillit plutôt sur la ligne très fine qui sépare, dans les deux récits, la loi et la transgression[4] ».
Devant cette ouverture à l’altérité, on se prend à rêver d’une théologie qui approfondirait le rôle de « sœur », au sens où les compétences féminines seraient désormais reconnues y compris pour guider la communauté en matière de prise de parole, d’encadrement et d’organisation. Explorons alors le Nouveau Testament.

Les évangiles auraient-ils été moins éloquents dans leurs modèles ? Une relecture expurgée de ses biais androcentriques nous prouve le contraire.
Plus tardif que les évangiles appelés synoptiques (Marc, Matthieu et Luc) celui de Jean ne raconte pas toute la vie de Jésus. Le choix des interlocuteurs que le narrateur fait dialoguer avec Jésus est très important. En effet, il montre que les premiers fidèles sur lesquels le Seigneur fonde son enseignement ne réduisent pas le paradigme du disciple et de « l’envoyé » à sa composante masculine. Et nous allons constater, à l’instar de Raymond E. Brown, « qu’accorder à une femme un rôle traditionnellement attribué à Pierre peut bien être, de la part de Jean, une accentuation délibérée.[5] »
Cette analyse sera hélas, peu entendue… Or il est impossible de minorer l’exceptionnelle place accordée aux femmes dans ce quatrième évangile et ce que leur apparition, à sept endroits clés du récit, permet de mettre en valeur.
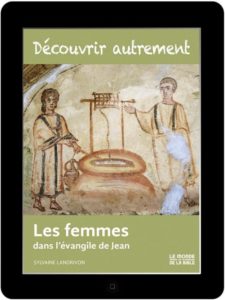 En parcourant très vite cet évangile, nous observons que dès le début, c’est Marie, la mère de Jésus, qui préside à la réalisation du premier « signe », point de départ de la Révélation.
En parcourant très vite cet évangile, nous observons que dès le début, c’est Marie, la mère de Jésus, qui préside à la réalisation du premier « signe », point de départ de la Révélation.
Au chapitre 4, nous rencontrons la Samaritaine au puits de Jacob. Jésus va lui dévoiler sa messianité et elle va devenir une incomparable missionnaire.
Au chapitre 8, (en acceptant cet épisode comme johannique) la femme adultère entre en scène donnant l’occasion d’un repositionnement de la Loi.
Les chapitres 11 et 12 nous proposent de nouvelles leçons de foi et de théologie par les voix croisées de Marthe et Marie de Béthanie.
Puis nous retrouvons au pied de la Croix, la mère de Jésus et d’autres femmes dont Marie dite de Magdala, laquelle, trois jours plus tard, constatera l’absence de Jésus au tombeau, rencontrera son Seigneur, et fera le lien entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi. Elle viendra alors annoncer aux disciples restés à distance, la merveilleuse nouvelle de la résurrection.
Par conséquent, minorer la place et le rôle des femmes dans cet évangile tient de la gageure ! L’une d’entre elles peut devenir paradigmatique de l’écart entre la perception traditionnelle et une approche plus sérieusement théologique du message : il s’agit de Marie de Magdala.
Observons de plus près cette Marie è magdalènè dite Marie Madeleine. Nous allons confronter la majesté d’un modèle chanté en Orient[6] à la distorsion du personnage qu’en a faite un pape, dans un amalgame dont nous peinons à sortir.
Comme pour Judith, l’art s’est volontiers emparé du personnage de Marie Madeleine, pour nous en offrir une vision bien peu conforme aux évangiles. C’est ainsi que nous avons tous en tête une certaine image d’elle. Alanguie, éplorée, souvent dénudée et cheveux défaits, la Magdaléenne nous apparaît dans une illustration qui mélange :
- ce que nous dit Luc au chapitre 7 sur une « femme pécheresse »,
- les diverses scènes d’onctions, dont celle qu’accomplit Marie de Béthanie,
- et ce qui se passe au moment de la résurrection, notamment en Jean 20.
Cette image est portée par notre culture et notre tradition occidentale, mais elle n’est ni neutre, ni innocente. Très vite en effet, deux figures de Marie Madeleine se sont fait jour et elles sont irréconciliables.
L’Occident, va faire de Marie-Madeleine une pécheresse, noyée dans ses larmes. Elle doit illustrer la conversion de la luxure en passion mystique qui rejoint la miséricorde divine et elle va ainsi servir une théologie de la repentance. Cette figure, -qui n’a rien de biblique-, est l’œuvre de Grégoire le grand (nous l’expliquerons). A l’inverse, l’Orient fait immédiatement mémoire de la mission qui lui est conférée par Jésus-Christ et ne l’assimilera jamais aux autres femmes des évangiles.
Il apparaît donc important d’observer comment s’élabore ce personnage, avec cette question : de quelle Marie parle-t-on ?
Comme plusieurs femmes se prénomment Marie, et que d’autres ne sont pas nommées du tout, cela va donner l’opportunité de fusion facile entre les divers personnages.
Pour cerner l’identité de chacune, il faut dissocier les scènes d’onction (c’est-à-dire les passages où une femme va se pencher sur Jésus pour répandre de l’huile parfumée sur lui)[7], des épisodes en lien avec la Passion et la Résurrection. Notons, pour mémoire, que le nom de Magdala n’est jamais mentionné dans les scènes d’onction quel que soit l’évangile.
En outre, l’évangile de Jean ne laisse pas la moindre place à un mélange des personnages, et va même faire de Marie M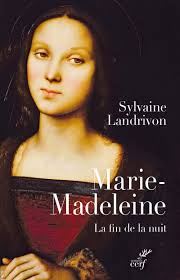 adeleine, une disciple parfaite, qui, dans sa fidélité et dans sa foi, apparaît très semblable à la mère de Jésus.
adeleine, une disciple parfaite, qui, dans sa fidélité et dans sa foi, apparaît très semblable à la mère de Jésus.
Comparons leurs portraits dans ce qu’en relate le rédacteur Johannique pour en exposer l’importance :
Nous allons notamment découvrir que les situations et dialogues entre Jésus et sa mère, décrits lors du premier signe de Jésus à Cana, reçoivent leur fidèle écho au jour de la résurrection avec Marie de Magdala.
Cinq scènes se présentent en miroir :
- Dans les deux cas : nous sommes au troisième jour; 3ème jour après le baptême de Jésus à Cana ; 3ème jour après la mort de Jésus pour sa rencontre avec Marie Madeleine. Et cette mention du 3ème jour n’est pas rien puisqu’elle nous fait signe aussi vers les grands événements de l’histoire biblique notamment vers la manifestation de Dieu dans le livre de l’Exode : « c’est au troisième jour que le Seigneur descendra sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. » (Ex 19,11b). Il ne s’agit de rien de moins, dans ce verset du livre de l’Exode, que de l’annonce de l’alliance de Dieu avec son peuple.
- Ensuite dans les deux cas, à Cana comme au jardin, une femme constate un manque: absence de vin (avec toute la symbolique de ce vin) à Cana ; disparition du corps de Jésus au tombeau.
- Et à Cana comme au jardin, les deux femmes se confrontent à une interpellation directe de Jésus: « femme, que me veux-tu ? » Jn 2,4 – « femme, qui cherches-tu ? » Jn 20,15.
- Le parallèle entre les deux événements se prolonge encore plus loin puisque dans les deux cas, Jésus va utiliser ces voix féminines comme intermédiaires -pas médiatrices car nous croyons évidemment en un seul Médiateur : le Christ- ; il va les prendre comme messagères de l’incroyable. C’est donc désormais par des bouches féminines aussi, que nous retrouvons le schéma classique des récits d’alliance dans lesquels le peuple s’engage à obéir à la Parole.
- Enfin, au terme, les deux femmes s’adressent à la communauté pour révéler ce qu’elles ont découvert du lien entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi.
 Ainsi, à Cana ce n’est pas d’abord Jésus qui s’exprime mais Marie sa mère, qui dit aux serviteurs : « tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Jn 2,5. Elle prend la parole au nom de Jésus (devenant le premier disciple à s’exprimer en son nom)[8].
Ainsi, à Cana ce n’est pas d’abord Jésus qui s’exprime mais Marie sa mère, qui dit aux serviteurs : « tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Jn 2,5. Elle prend la parole au nom de Jésus (devenant le premier disciple à s’exprimer en son nom)[8].
Avec Marie de Magdala à l’heure de la Résurrection, c’est à elle que revient la charge de transmettre aux disciples, un inouï encore plus incommensurable que celui exposé à Cana. Et là, nous vivons encore davantage la réalisation de la promesse qui conforte l’idée d’alliance et de fête car, comme le texte nous l’enseigne par l’échange avec le Christ ressuscité : nous apprenons que Jésus monte vers son Père qui est aussi notre Père. Notre seul Père ! (cf Mt 23.9) et nous sommes tous invités à nous réjouir d’une annonce qui dit notre salut.
Étudiée sous cet angle, la cause paraît donc entendue, quant à la noblesse et à l’importance théologique et ecclésiologique de la Vierge Marie, bien sûr, et de Marie de Magdala ; et c’est bien ainsi que tout l’Orient va honorer la Magdaléenne, fidèle à l’enseignement de Romanos le Mélode. Car cette lumière portée sur Marie Madeleine n’est pas le seul fait de la réflexion contemporaine. Elle a eu très tôt ses adeptes, dont le saint poète Phénicien.
Romanos est né à la fin du Ve siècle. Il va consacrer plusieurs de ses hymnes à Marie de Magdala et pour lui, il n’existe aucun lien entre la pécheresse de Luc et Marie de Magdala, ni entre Marie de Magdala et les femmes des scènes d’onction.[9]
Dans tous les évangiles, les compagnons masculins de Jésus, suite à l’arrestation et à la condamnation de celui qu’ils avaient honoré comme le Messie, nous sont montrés défaits et désabusés, ayant renoncé à toute espérance. Romanos place les femmes dans un mouvement inverse. La Croix n’interrompt pas leur élan et, comme lorsqu’elles suivaient et accueillaient le Galiléen cheminant vers son destin, Romanos expose la façon dont elles se maintiennent dans leur foi.[10]
En outre, pour Romanos, Marie de Magdala est consolatrice, enseignante. Sa mission est dirigée vers l’extérieur : elle « publie », « explique ».
« Que ta langue désormais publie ces choses, femme, et les explique aux fils du royaume qui attendent que je m’éveille, moi, le Vivant. Va vite, Marie, rassembler mes disciples. J’ai en toi une trompette à la voix puissante : sonne un chant de paix aux craintives oreilles de mes amis cachés, éveille-les tous comme d’un sommeil, afin qu’ils viennent à ma rencontre. » Romanos le mélode, Hymnes, 4 § 12
Elle enseigne, elle explique et, en plus, elle rassemble. Si c’est elle qui rassemble le troupeau, elle devient non seulement le premier témoin de la résurrection mais aussi le premier maillon de l’assemblée qui formera l’Église.
Elle possède ainsi ce qui constitue les trois piliers ou charges du sacerdoce (que l’on nomme les tria munera) : la sanctification à travers l’idée de « publier » la parole de Jésus, le rôle d’enseignement avec « explique » et celui de gouvernement avec « rassemble ».
Et cette posture, si étonnante à nos regards occidentaux, nous permet de découvrir Marie Madeleine tout autrement, au point de percevoir qu’elle possède des ressemblances avec d’autres acteurs bibliques et pas seulement avec la mère de Jésus comme nous l’avons déjà repéré, mais aussi avec Moïse et Paul.[11]
Pourtant de nombreux Pères occidentaux, bien que lui reconnaissant très vite le titre « d’apôtre des apôtres » vont chercher d’autres pistes pour présenter Marie-Madeleine, et c’est l’assimilation à la pécheresse décrite par Luc qui va être la plus fructueuse. Nous allons vite repérer que le grand responsable de cet amalgame s’appelle Grégoire le grand.
 Grégoire le grand vit au VIe siècle. Presque contemporain de Romanos, il est élu pape en 590. Rome à cette époque traverse une crise terrible et Grégoire veut remettre de l’ordre, redonner des normes. Il va alors réaliser ce que les théologiens nommeront un « tour de force » exégétique, afin de mettre en place une théologie de la repentance.
Grégoire le grand vit au VIe siècle. Presque contemporain de Romanos, il est élu pape en 590. Rome à cette époque traverse une crise terrible et Grégoire veut remettre de l’ordre, redonner des normes. Il va alors réaliser ce que les théologiens nommeront un « tour de force » exégétique, afin de mettre en place une théologie de la repentance.
Alors que ses prédécesseurs semblaient incertains sur l’identité des femmes autour de Jésus, il va rassembler tous les passages des évangiles où elles apparaissent, et va ainsi réunir en une seule femme, la pécheresse décrite par Luc, et les diverses Maries autres que la Vierge.
Il a clairement annoncé cette fusion des personnages au début de son Homélie XXXIII campant celle autour de laquelle il concentre les figures : il s’agit -dit-il- de la femme qui est « remplie de tous les vices » interprétant ainsi le texte qui dit que Jésus avait chassé de cette femme «sept démons ». Marie ainsi présentée, il peut ensuite nous exposer le chemin de la rédemption : « Souillée de tant et tant de fautes, Marie-Madeleine s’en vint aux pieds de notre Rédempteur, en larmes »
À partir de cette peinture de Marie-Madeleine, les femmes vont se trouver cantonnées dans une représentation strictement sexuée[12]. Et tout à ce travail de contrôle d’un débordement pulsionnel, Grégoire présume que lorsque cette pauvre femme se sera ouverte à un amour plus pur, elle ne pourra que se consumer dans les larmes du repentir, débordant d’amour passionnel pour son Rédempteur.
Il n’est désormais plus possible de voir dans ce portrait, une disciple à l’égal de Pierre ou de Marie.
 Pourtant quelque chose de la figure orientale chère à Romanos, parvient jusqu’à nous comme en témoigne Jacques de Voragine dans La légende dorée (XIIIe s). C’est ainsi que nous la voyons prêcher à Marseille sur un tableau datant du XVIe siècle.
Pourtant quelque chose de la figure orientale chère à Romanos, parvient jusqu’à nous comme en témoigne Jacques de Voragine dans La légende dorée (XIIIe s). C’est ainsi que nous la voyons prêcher à Marseille sur un tableau datant du XVIe siècle.
Mais le « coup de force » a opéré et toutes les femmes en sont atteintes avec elle.
Nous disposons désormais de l’appui de l’exégèse et de la théologie pour reconstruire le personnage, et nous demander, à nouveau frais :
Marie de Magdala est-elle témoin et/ou apôtre ?
Être apôtre selon Y Congar signifie avoir vu le ressuscité et avoir reçu de lui une mission, ce que nous retrouvons dans l’invitation de Jésus à Marie de Magdala : « Va trouver mes frères… dis-leur ».
D’autre part, nous savons qu’elle est nommée « Apôtre des apôtres ». Cette expression au superlatif absolu est très ancienne. Elle vient d’Hippolyte de Rome au IIIe siècle et elle trouve plus tard un sérieux appui chez saint Thomas d’Aquin. Elle sera ensuite confirmée par de nombreux papes, y compris Benoît XVI[13] qui dans son analyse du Commentaire sur l’Évangile de saint Jean de saint Thomas d’Aquin cite quelques lignes du § 2519 dans lesquelles le Docteur angélique est très clair :
« elle [Marie de Magdala] a reçu un rôle apostolique ; bien plus, elle est devenue apôtres des apôtres en ceci qu’il lui fut confié d’annoncer aux disciples la Résurrection du Seigneur. »
Mais l’importance de son rôle aurait pu se lire aussi dans son nom qui évoque une « tour », autrement dit qui la place en position de surplomb. En effet, déjà st Jérôme écrivait à sa disciple Principia : « c’est vraiment une gardienne de tour ou plutôt une tour blanche » et Thomas d’Aquin suggère le même rapprochement entre son nom et l’idée de tour[14].
Alors nous vient une question : Si Marie était dite « magdal », non pas en référence à une ville qui n’existait pas encore sous la dénomination de Magdala, mais pour exprimer la tour, la gardienne, comme Simon est appelé « pierre » ou Judas dit « l’Iscariote » (le traitre) ?
Nous voici donc avec deux représentations bien différentes de cette femme.
L’une, sans fondement scripturaire, nous montre une prostituée repentie absorbée dans son élan mystique, pleine d’amour éperdu pour son Sauveur et se repentant dans les larmes de ses nombreux péchés sexuels. L’autre a la faveur de l’Orient et de la plupart des théologiens contemporains ; elle valorise une femme amie de Jésus, témoin de sa Résurrection et première envoyée. Alain Marchadour repère qu’à la croix, cette femme exceptionnelle est : « témoin et acteur silencieux de la naissance de l’Église » et que lors de sa rencontre avec le ressuscité, « elle devient la première missionnaire[15]
Revenir à la source biblique de ce personnage est réconfortant pour tous ceux, toutes celles, qui veulent voir un peuple de Dieu dans lequel hommes et femmes sont également image et ressemblance de Dieu, égaux en dignité et en potentialité de responsabilités.
Par ces modèles, sortir les femmes de l’obscurité
Par ces illustrations féminines, nous avons mis à jour des postures faites de fidélité, de confiance, d’autorité même, qui pourraient faire retour vers une nouvelle manière d’accueillir et d’intégrer l’ensemble des femmes à la vie de l’Église, dans une configuration finalement plus conforme à ce que proposent les Écritures que celle en vigueur aujourd’hui. Ce ne sont pas les seules figures féminines qui attestent de l’importance de la parole et de l’action des femmes au même titre que celles des hommes.
Lorsque la Samaritaine après avoir échangé auprès du puits avec Jésus, interpelle les gens de son peuple, elle les sollicite par une question : « Venez donc voir un homme (…) ne serait-il pas le Christ ? » (Jn 4,29). Sa stimulation attise leur intérêt et en même temps les invite à aller encore plus loin qu’une confession messianique. En découvrant que Dieu s’adresse à tout humain sans discrimination de lieu, de sexe ou de fonctions, les Samaritains comprennent que le « salut qui vient des Juifs » (Jn 4, 22) les concerne eux aussi par son universalité, et qu’ils peuvent prendre part à cette Bonne Nouvelle. Comme l’écrit Alain Marchadour, « Entre Jésus et la Samaritaine se joue une rencontre qui rappelle que l’Alliance entre Dieu et son peuple ressemble toujours à l’amour entre l’homme et la femme.[16] » Cette allusion n’est sans doute pas à négliger dans ce qu’elle transmet quant à la nécessité de deux paroles distinctes et toujours en dialogue pour témoigner de la révélation.
De même avec l’échange entre Marthe et Jésus : elle déclare : « je crois que TU es le Christ, le Fils de Dieu… », posant ainsi toutes les bases de la christologie ce qui fait d’elle une disciple d’une acuité que ne possèdent pas les Douze. Seule la Magdaléenne, lors de la rencontre au jardin après la résurrection sera capable d’une égale clairvoyance. Le parallèle le plus proche de cette confession de foi de Marthe se trouverait en Mt 16,16 lorsque Pierre déclare à Jésus « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », mais alors Jésus ne poursuit pas, comme pour Marthe, jusqu’à se révéler dans le mystère de la Résurrection. Seules deux témoins, deux femmes : Marthe et Marie Madeleine ont eu ce privilège de partager le sens de la résurrection.
C’est pourquoi l’évangile de Jean impose de considérer autrement, la manière dont Jésus choisit de déposer son message et le rôle qu’il accorde aux femmes dans la charge de reformuler et transmettre son enseignement.
S’il fallait encore un exemple : l’onction que fait Marie de Béthanie sur Jésus peu de temps avant son arrestation, met en scène une femme dont rien ne laissait supposer ses liens discrets avec Jésus. Or, la scène nous fournit une indication précieuse. Le geste de Marie, qui anticipe la Passion, n’a pas pour objet de cautionner un messianisme royal ; Marie n’est pas dupe de cette attente erronée portée par de nombreux disciples masculins. C’est pourquoi elle n’a pas oint la tête de son Seigneur mais ses pieds. Elle a bien compris qu’il ne sera pas roi selon les lois humaines. Elle connaît le sort qui attend Jésus, et quelle royauté il inaugure.
On se dit alors que Lazare, comme bénéficiaire d’un relèvement de la mort, aurait pu être le vecteur de cette annonce, mais l’évangile de Jean persévère dans la valorisation de postures féminines pour marquer les temps forts de l’enseignement de Jésus. Et Lazare demeure muet.

Si nous voulons nous interroger sur la manière de vivre aujourd’hui ces témoignages des évangiles, nous pouvons nous demander pourquoi ne pas reconsidérer tous les rôles dans une complémentarité sans subordination ?
Une collaboration sans hiérarchie arbitrairement dégradée, se lit dans les termes des tout premiers versets bibliques. Les mots de Genèse 2,18 : « ezer kenegdô », sont la plupart du temps interprétés comme une « aide » apportée par la femme au premier humain décrété mâle par la tradition. Le respect du texte voudrait au contraire que l’on traduise le mot hébreu ezer comme pour toutes les autres occurrences bibliques de ce mot, c’est-à-dire, dans son sens de « secours » et non d’« aide ». La force de ce terme employé habituellement pour qualifier Dieu qui vient au secours de son peuple, dit assez, dès le début du récit, l’importance qu’il conviendra d’accorder à une solidarité perpétuelle entre le masculin et le féminin pour cheminer dans les voies du Seigneur, puisque le terme vise un secours mutuel, à l’égal de celui que Dieu accorde au peuple avec lequel il a conclu une alliance. Ce qui s’entend déjà dans la Genèse n’est pas contredit, loin s’en faut, dans le Nouveau Testament. Nous l’avons vu à travers l’Evangile de Jean.
Dans ses épîtres authentiques, Paul lui-même nous encourage à changer de regard : il explique à la communauté des Galates, qu’en Christ il n’y a ni grecs ni juifs, ni hommes ni femmes. S’adressant aux Corinthiens, il aborde la question des femmes qui prophétisent voilées : on se focalise sur le voile, on fait semblant d’oublier qu’elles sont invitées à prophétiser… Et dans de nombreuses lettres, Paul mentionne ses collaboratrices en recommandant Phoébé, ministre de l’église de Cenchrée, saluant Prisca qui instruit Apollos, Junia qu’il nomme « apôtre »…
Les appuis scripturaires ne manquent donc pas pour revaloriser la place des femmes ; mais bien entendu, il faut sortir des schémas habituels hérités d’Aristote sur l’infériorité féminine, afin de réparer les dommages générés par des siècles d’entre soi masculin visant notamment à la confiscation de l’étude et de la parole.
Bibliographie sommaire
BEAUCHAMP Paul, Cinquante portraits bibliques. Paris, Seuil, 2000.
BROWN Raymond E., La communauté du disciple bien-aimé, Traduit de l’anglais par F. M. GODEFROID, Coll. « Lectio divina 115 », Paris, Éditions du Cerf, 2010.
FIORENZA Elisabeth Schüssler, En mémoire d’elle. Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe,», Traduit de l’américain par Marcelline BRUN, Coll. « Cogitatio Fidei N 136 » Paris, Éditions du Cerf, 1986.
GRÉGOIRE le GRAND, Homélies sur l’Évangile. Livre II, Homélies XXI-XL, Texte latin, introd., trad. et notes par Raymond ÉTAIX †, Georges blanc, s.j. et Bruno JUDIC, Coll. « Sources Chrétiennes 522 », Paris, Éditions du Cerf, 2008.
LANDRIVON Sylvaine, Faites-les taire. Judith, un enseignement subversif, Lyon, Olivétan, 2014
LANDRIVON Sylvaine,, Marie de Magdala « apôtre » ? Vers une ré interrogation du rôle des femmes dans l’Église, Paris, Éditions du Cerf, 2017, 208p, et Sylvaine LANDRIVON, Marie-Madeleine. La fin de la nuit, Paris, Éditions du Cerf, 2017, 230p.
MARCHADOUR Alain, Les personnages dans l’évangile de Jean. Miroir pour une christologie narrative, Coll. « Lire la Bible », Paris, Éditions du Cerf, 2004, Ed. 2011.
PELLETIER Anne-Marie, L’Église, des femmes avec des hommes, Paris, Éditions du Cerf, 2019.
SINGLES Donna, L’homme debout : le credo de saint Irénée. Paris, éditions du Cerf, 2008.
FEMMES ET RECHERCHE RELIGIEUSE, Théologies chrétiennes au féminin, Lyon, Chronique Sociale, 2011.
Notes :
[1] Constitution Gaudium et spes § 29.
[2] Anne-Marie Pelletier, L’Église, des femmes avec des hommes, Paris, Éditions du Cerf, 2019, 248p.
[3] Sylvaine Landrivon, Faites-les taire. Judith, un enseignement subversif, Lyon, Olivétan, 2014.
[4] Paul Beauchamp, Cinquante portraits bibliques. p. 240.
[5] Raymond E. Brown, La communauté du disciple bien-aimé, Traduit de l’anglais par F. M. Godefroid, ( Lectio divina 115), Paris, Éditions du Cerf, 2010, p. 208.
[6] Sylvaine Landrivon, Marie de Magdala « apôtre » ? Vers une ré interrogation du rôle des femmes dans l’Église, Paris, Éditions du Cerf, 2017, 208p, et Sylvaine Landrivon, Marie-Madeleine. La fin de la nuit, Paris, Éditions du Cerf, 2017, 230p.
[7] Des scènes d’onction se rencontrent dans chaque évangile.
- Elles sont semblables chez Marc (14,3-9) et chez Matthieu (26,6-13) : l’action se passe chez Simon le lépreux à Béthanie ; il s’agit d’une femme anonyme, et l’onction sur la tête de Jésus illustre une préparation de la Passion qui approche.
- Tout change avec Luc 7, 36-50. La scène se déroule bien chez un personnage nommé Simon, mais il est appelé Simon le Pharisien et il n’y a aucune mention géographique. D’autre part la femme est qualifiée de pécheresse et l’onction a lieu sur les pieds et non pas sur la tête. Comme chez Marc et Matthieu elle n’est pas nommée. Or il faut noter que Marie de Magdala apparaîtra sous son propre nom quelques versets plus loin (s’il s’agissait d’elle, pourquoi ne l’aurait-il pas nommée dès cette scène ?). En outre, par la position de ce récit, à distance de la scène de la Passion, nous sortons d’un lien d’anticipation : il ne s’agit pas d’une reconnaissance de Jésus comme « Messie » (ce lui qui est oint). Ici, chez Luc, le récit – bien différent des autres-, veut plutôt mettre en évidence une explication du thème rétribution-conversion (selon le schéma : péché-contrition-rédemption).
– Enfin, Jean va se ressaisir à son tour de ces scènes, mais tout autrement et en deux temps. D’abord au chapitre 11, Jean évoque une onction sur les pieds de Jésus (comme Luc) mais il l’attribue à Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Tout rapprochement direct avec Luc ferait de Marie de Béthanie, une pécheresse, sous-entendu une prostituée… ce que n’hésitera certes pas à faire Jacques de Voragine ; mais dans cet évangile, elle est présentée comme l’amie de Jésus, celle qui a « la meilleure part » et rien, dans la suite du texte ne permet de douter de sa moralité. Nous verrons sur quel terreau a germé l’idée de notre auteur dominicain.
Mais pour revenir à l’évangile, ce qui est plus surprenant encore c’est que Jean reprend cette scène au chapitre suivant (en Jn 12,1-8) et, loin de réutiliser le scénario décrit par Luc, c’est bien à une préparation de la Passion que nous assistons.
[8] Marie le nomme par « Il » : un pronom personnel qui ne prononce pas le nom de Dieu mais qui en connaît la puissance ; et elle convoque les serviteurs dans une action, dans un « faire » qui sonne comme un écho à la réponse du peuple à Moïse en Ex 24,3 ce « nous ferons » qui les engage à réaliser les commandements de Dieu.
[9] Il s’appuie essentiellement sur l’évangile de Jean mais connaît probablement les évangiles apocryphes dont la Pistis Sophia et l’Évangile selon Marie redécouverts au milieu du XXe (en 1930 dans le Fayoum égyptien puis à Nad Hammadi en 1945, puis un autre document plus complet en 1983). Ces documents donnent un rôle majeur à Marie de Magdala et dans l’Évangile selon Marie elle est placée à la tête du groupe des apôtres. Cela va colorer l’image qu’en donne Romanos. Il redistribue les rôles et les explique.
[10] Dans le début de son hymne N° 1 sur la résurrection, il pense que les femmes pleurant devant le tombeau vide évoquent la possible résurrection du Christ. Au paragraphe 2, il nomme ces femmes aï théophoroï, expression que l’on pourrait traduire par « soutien du Seigneur » et généralement réservée aux grands inspirés comme les prophètes, ou aux Pères apostoliques. Attribuée à Marie, objet des vers suivants, le qualificatif met en valeur l’anticipation de sa foi en la résurrection du Christ.
[11] Dieu ne s’adresse-t-il pas à Marie comme il le fait au premier chapitre du Lévitique quand il interpelle Moïse ? Le parallèle est assez saisissant : D’un côté nous lisons : « YHWH appela Moïse et, lui parla et lui dit : Parle aux Israélites ; tu leur diras : » (Lv 1,1-2). De l’autre : « elle ne savait pas que c’était Jésus » ; « Jésus lui dit : “Marie !” » et « Jésus lui dit : “Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur :… » (Jn 20,14b-17).
Dans les deux cas, le Seigneur n’est pas d’abord clairement objectivé. Le texte hébreu pour dire l’appel : « vahiqra » n’a pas de sujet nommé : Moïse ne sait pas qui appelle ; de même que Marie ne sait pas immédiatement qu’elle a affaire à Jésus (qu’elle prend d’abord pour un jardinier).
Ensuite vient le contenu religieux destiné à un interlocuteur précis, quand le Seigneur oriente le dire vers celui ou celle qu’il s’est choisi. Il appelle l’individu « Moïse » de la même manière qu’il s’adresse à Marie par son nom. De cet appel divin, provient un « me voici », celui-là même que prononce Samuel à l’appel de son nom en 1S 3,4-8. Il est donc bien question de l’émergence d’une disponibilité, qui, dans tous ces cas, va consister à se tourner vers la communauté pour transmettre le message reçu.
Enfin, s’adressant à Moïse comme à Marie de Magdala, le Seigneur commande et envoie : « parle », « va trouver… ». Et il faut noter que dans les deux scènes, le message peut ne pas être cru : il ne repose sur aucune preuve tangible. Pour Moïse, les tables de la loi ont été brisées ; quant à Jésus : qui croira sur le champ qu’il est vraiment ressuscité ?…
Remarquons au passage que dans toute l’histoire biblique, ceux que Dieu convoque pour témoigner, transmettre son message ou sa Parole, ne sont jamais ceux qui semblent d’emblée adaptés à cette fonction. Moïse avoue dès le début qu’il est incapable de parler, ce qui l’obligera à recourir à l’aide de son frère ; Jonas devant aller à Ninive s’enfuit d’abord au plus loin par le premier bateau, écrasé sous le poids de la charge qui lui est confiée ; et Jérémie est un tout jeune homme (naar), si jeune que nul ne l’inviterait à parler en public. Quant à Judith, déjà rencontrée ici, elle n’est agréée que comme ultime recours quand tout espoir a été abandonné.
La méthode changerait-elle dans le Nouveau Testament ? Il n’en est rien. C’est à Marie de Magdala, une femme, qu’il est demandé d’aller annoncer la résurrection ; or chacun sait, qu’au temps de Jésus, son témoignage est administrativement, socialement, nul, et qu’il devra être relayé par d’autres, s’il veut être entendu. Et pourtant, tous ces envoyés sont dans leur rôle sans erreur possible : Jérémie est choisi « dès le sein de sa mère », et la magdaléenne, quelque embarras qu’elle donne aux commentateurs, est bien la seule mandatée pour annoncer l’incroyable nouvelle d’un acte qui révèle le salut de tous.
Donc Marie de Magdala possède des points communs avec Moïse. Elle en a aussi avec le disciple bien aimé puisque comme lui, elle partage la même proximité, le même amour d’agapè avec Jésus.
Un rapprochement avec Paul pourrait intriguer davantage. Pourtant, là encore, la proximité est manifeste. Leurs modes d’entrée en scène sont identiques : Marie est guérie de maladie, Paul de son aversion pour les chrétiens. Dans les deux situations, il s’agit d’une rencontre personnelle avec le ressuscité qui les appelle par leur nom. De plus, ni l’un ni l’autre n’appartient au groupe des Douze et l’un et l’autre peuvent paraître suspects : Marie parce qu’elle est femme et Paul citoyen romain. Enfin, tous deux sont envoyés en mission pour aller propager la Bonne Nouvelle.
[12] C’est le côté féminin au sens de « femelle » et même de femelle lubrique, qui est scrupuleusement mis en exergue. Les démons chassés sont devenus des vices.
[13] Voir son audience du 14/02/2017.
[14] Dans son Explication suivie de l’Évangile de Jean, il écrit : « Dans le sens allégorique, Marie qui signifie maîtresse, illuminée, illuminatrice, étoile de la mer, est la figure de l’Église. Elle s’appelle aussi Madeleine, c’est-à-dire, élevée comme une tour, car le mot Magdal, en hébreu, a la même signification que le mot turris en latin. Or, ce nom qui est dérivé du mot tour, convient parfaitement à l’Église, dont il est dit dans le Psaume 60 : ” Vous êtes devenu pour moi une forte tour contre l’ennemi. ” »
[15] Alain Marchadour, Les personnages dans l’évangile de Jean. Miroir pour une christologie narrative, (Lire la Bible), Paris, Éditions du Cerf, 2004, Ed. 2011, p.116.
[16] Alain Marchadour, Les personnages dans l’évangile de Jean. Op. cit., p.84.
Un commentaire sur “Conférence Café Simone 23/11/2021 S Landrivon Les femmes et la Bible”