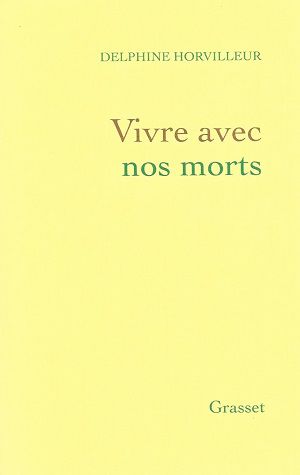Delphine Horvilleur, Vivre avec nos morts. Petit traité de consolation, Paris, Grasset, 2021.
Recension par Sylvaine Landrivon
 Dans l’Église catholique, le lieu que délèguent le plus volontiers les prêtres, ce sont les funérailles.
Dans l’Église catholique, le lieu que délèguent le plus volontiers les prêtres, ce sont les funérailles.
Dès les premières lignes de son livre, nous comprenons que le rabbin Delphine Horvilleur se situe différemment et accorde toute sa présence et sa compétence aux familles endeuillées pour leur offrir la dimension du sacré indispensable à cette épreuve. Elle intervient à travers l’outil de la parole, du récit.
Dans un langage clair, se fondant sur des situations concrètes, l’autrice montre l’importance de trouver les mots et les gestes qui vont toucher le cœur et consoler.
Delphine Horvilleur conçoit donc cette partie de sa charge de rabbin comme étant d’abord celle d’une conteuse. « Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner à celui qui entend l’histoire pour la première fois des clés inédites pour appréhender la sienne. » (p.17). En effet, les histoires savent créer des ponts par delà le temps, et sont capables d’ouvrir un passage entre les vivants et les morts, de « retisser des paniers en y ajoutant des fils » (p.81), autrement dit de conserver les liens d’une génération à l’autre. Ce sera le fil rouge de ce livre. Mais le rôle du rabbin ne se limite pas à cette dimension. Il ou elle doit « être le pilier d’une verticalité » (p.135), cette dimension qui a abandonné les endeuillés. Il ou elle ne doit pas céder à l’empathie mais demander à ceux qui souffrent de croire en un avenir, de croire en la possibilité de se relever.
Et dans le même temps, elle nous invite à croire en un Dieu qui a renoncé à sa toute puissance. De cet abandon de pouvoir au profit de notre liberté, Dieu rit, présume-t-elle, et elle a « du mal à croire que ce Dieu-là s’offusquerait par exemple, des unes de Charlie Hebdo » (p.35).
Sans emphase, ce livre clair et riche de beaux enseignements s’appuie sur des illustrations. Par l’expérience d’Elsa, l’autrice nous fait explorer la rencontre par l’enfance de la notion de finitude. Par celle du fils de Sarah, elle expose l’importance du récit car il faut, dit-elle : « Accompagner les endeuillés, non pas pour leur apprendre quelque chose qu’ils ne savaient déjà, mais pour leur traduire ce qu’ils vous ont dit, afin qu’ils puissent l’entendre à leur tour. » (p.80). Quant au drame de la mort du petit Isaac, pour laquelle la langue française ne possède même pas de mot qui dirait l’état de perte d’un enfant, il montre l’impossible réponse aux « pourquoi ?», et nous confronte à la vacuité, à la maladresse, de qui voudrait justifier ou expliquer. Delphine Horvilleur invite l’entourage à se préparer aux phrases qui veulent donner du sens à l’insensé. Puis elle observe les traditions rassurantes de certaines religions et confie : « J’envie ce langage du dogme infaillible et des croyances sanctuarisées » (p.114). Elle note que « pour chercher nos morts, il faut être capable de regarder simultanément dans toutes ces directions, sous terre comme au ciel, à la fin de l’histoire comme à son tout début. » (p.121). Et elle conclut humblement mais avec force : « j’ignore où se trouve Isaac. Mais je sais que sa famille, avec un amour éternel, continuera de le chercher, et parlera tous les langages d’une tradition qui garde en vie la question que sa mort pose. » (p. 124).
Quel que soit le contexte, avec ou sans histoire pour l’accompagner, la mort d’un être cher projette son entourage dans un temps à part. C’est l’un des sens du terme hébreu kadosh, sacré. Mais dans ce moment de séparation, l’autrice insiste sur l’importance de veiller au respect de la complexité de l’existence du défunt. Surtout ne pas la réduire au « tragique de son interruption ». Et Delphine Horvilleur d’espérer : « Pourvu qu’à nos enterrements, il nous soit permis de ne pas nous résumer à nos morts, et de faire sentir combien dans la vie, nous avons été en vie. » (p.45).
Un peu plus loin dans le livre, nous découvrons, -pour la plupart d’entre nous-, la légende de Skotzel, histoire à faire vibrer toutes les féministes, et dont l’autrice s’est espièglement souvenue lors des funérailles de Simone Veil. Dans cette amusante histoire, Skotzel, avocate de la cause des femmes auprès de Dieu, n’est toujours pas revenue de son face-à-face.
Puis l’aventure de Myriam nous montre jusqu’où peut nous conduire le désir de maîtriser la fin de vie et le passage par la mort. Elle dit aussi la peur, le refus d’accepter, qui se dissimulent dans le souci d’organiser ce qui l’environne.
Mais que faire de la peur de la mort, qui n’épargne ni les rabbins, ni les prêtres, ni les médecins ou les philosophes ? Croire que la foi exonère de cette peur est une erreur. Celle de l’autrice « n’a jamais eu ce pouvoir » (p.166) confie-t-elle. D’ailleurs elle rappelle que même Moïse qui a eu le privilège de rencontrer Dieu, n’accepte pas sa finitude.
L’espérance en la résurrection des morts serait-elle la clé ? Dans le judaïsme deux concepts se croisent : Olam Haze, le monde où nous vivons, et Olam Haba, l’au-delà, dont la Thora enseigne l’avant-goût. Mais la Thora ne nous rassure pas sur ce qu’il adviendra. Alors l’héroïsme, dit Delphine Horvilleur, « n’est pas de cesser d’appréhender la fin, mais de toujours nous soucier, même au fond de notre terreur, de ce qui, à notre mort, survivra. » (p.175). L’attitude juste passe par la transmission d’une génération à la suivante, en laissant « des traces dans lesquelles ceux qui nous suivent et nous survivent liront ce qu’il ne nous est pas encore donné d’y voir ». (p.180).
Un presque dernier chapitre nous entraîne en Israël avec l’autrice, au moment de la mort d’I. Rabin. Elle utilise le lieu pour nous donner cette superbe leçon relative au sol de la Terre promise : « elle n’est pas la terre où sont nés tes pères, mais le lieu qui ne te fera pas oublier d’où tu viens, et qui dans le souvenir de l’exil, t’apprendra à aimer un autre que tu acceptes de ne jamais complètement comprendre, ni posséder. » (p.202).
Le livre se termine sous le regard de « l’oncle Edgar » qui, depuis le tableau exposé au mur de la salle à manger, ne cesse d’observer la petite fille. Est-ce l’œil de Caïn mis en scène par Victor Hugo ? Cette toile n’est-elle pas plutôt un pont dans l’histoire familiale ? Par delà l’abomination de la Shoa, la petite fille devenue grande, retrouvera dans le cimetière de Westhoffen, la tombe de l’oncle Edgar, « un Abel parmi tant d’autres ». Même en Alsace, la bêtise et la peur n’auront pas suffi à couper les racines. La mort ne gagne pas. La mémoire entretient de profonds ancrages qui donnent la victoire à la vie « LeH’ayim ! »