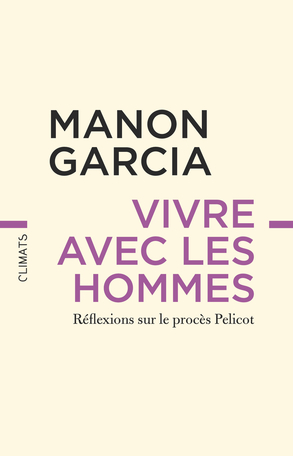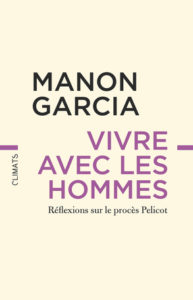 Manon Garcia, Vivre avec les hommes. Réflexions sur le procès Pélicot, (Climats), Paris, Flammarion, 2025, 224p.
Manon Garcia, Vivre avec les hommes. Réflexions sur le procès Pélicot, (Climats), Paris, Flammarion, 2025, 224p.
par Sylvaine Landrivon
Un sujet d’actualité, le procès Pélicot, qui s’est déroulé à Mazan en 2024, permet à la philosophe Manon Garcia de réinterroger la 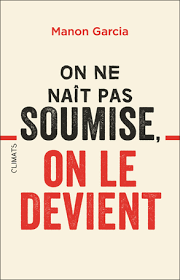 notion de consentement dans les relations sexuelles, et les rapports de domination hommes/femmes. Ce dernier sujet avait fait l’objet d’un précédent ouvrage On ne naît pas soumise, on le devient publié en 2018 chez le même éditeur.
notion de consentement dans les relations sexuelles, et les rapports de domination hommes/femmes. Ce dernier sujet avait fait l’objet d’un précédent ouvrage On ne naît pas soumise, on le devient publié en 2018 chez le même éditeur.
La réflexion part de l’analyse du comportement des protagonistes du procès, victime et coupables, pour montrer les limites du concept de « consentement ». Légiférer serait-il nécessaire ? Serait-ce suffisant ? L’autrice se positionne d’entrée en citant un propos de Robert Badinter sur l’efficacité relative de certaines lois. Elle ne remet évidemment pas en cause l’immensité des violences dénoncées par le mouvement #MeToo, « violences rarement punies parce qu’elles sont rarement dénoncées, rarement crues, et rarement correctement traitées[1] ». Elle note que chacun a une perception personnelle de ce qu’est une relation sexuelle ; celle de la plupart des policiers, par exemple, différera sans doute beaucoup de celle d’une « jeune écrivaine lesbienne urbaine ». Mais, en se focalisant sur la notion de consentement, elle remarque que dans le procès des viols de Mazan, comme dans d’autres, « le consentement n’est pas absent mais au contraire absolument omniprésent[2] » dans les débats. A l’instar de la sociologue Océane Pérona, qu’elle cite, elle précise que policiers et magistrats interrogent les mis en cause sur leur connaissance de cet aspect et met en évidence qu’il existe de nombreux biais dans cette approche. Toutefois, dans les motivations écrites transmises par la cour à la fin du procès, l’autrice souligne que « le consentement est l’objet de nombreux paragraphes, qui démontrent une compréhension de son importance extrêmement avancée[3] ». Cette observation la conduit à penser que « le changement de définition du viol que certaines appellent de leurs vœux est inutile[4] », car le problème n’est ni légal ni juridique. Elle s’en explique : il existe un véritable « gouffre » entre la compréhension qu’en ont le ministère public, les avocats, les policiers et « l’incompétence parfois non feinte des mis en cause sur la question[5] ». Pourquoi demander l’accord d’une femme endormie quand on est invité à en abuser par son mari ?!
Manon Garcia approfondit la question et note qu’en droit civil, le consentement constitue le fondement des contrats, mais ce vocabulaire devient inadapté dans le cas des viols. Les coupables savent qu’ils commettent un acte interdit et il ne s’agit pas de droit civil mais de justice pénale, ce qui change les rapports. Le juge va montrer que les accusés avaient l’intention de commettre le crime qu’ils ont commis et l’autrice rappelle les trois éléments qui qualifient un crime : « un élément légal, un élément matériel et un élément moral ou intentionnel[6] ». Les trois sont réunis ici : un viol est illégal. Les vidéos attestent de leur réalité et l’intention des coupables est avérée. À aucun moment la cour n’a présumé que Gisèle Pélicot était consentante.
Sur ce point précis, le procès met en évidence que les hommes interrogés cernent mal ce qu’est le consentement.
Ensuite, ce qui va retenir l’attention de l’autrice dans ce procès c’est la « normalité des mis en cause ». Certes un court chapitre montre l’incidence récurrente de l’inceste dans leur parcours de vie, mais, Dominique Pélicot excepté, ces individus reflètent globalement toute la société et n’ont « rien d’autre en commun que leur sexe [7]». On est alors évidemment renvoyé à Hannah Arendt, et l’autrice ne résiste pas à la tentation amusante malgré l’horreur décrite d’évoquer en écho, « la banalité du mâle ». Mais plus sérieusement et tragiquement, comme avec Eichmann, la société joue un rôle important et cette complicité ambiante silencieuse est là aussi « pratiquement omniprésente », hélas. Ici elle ne s’appelle pas antisémitisme mais « patriarcat » ou plus globalement référence aux hommes. Manon Garcia va donc interroger ce qu’il faut entendre par « masculinité(s) ».
Il faut se souvenir des interventions de Nathalie Heinich, Sylviane Agacinski, Elisabeth Roudinesco, dans Le Monde durant le procès, critiquant sur ce dossier des discours « néo féministes ». On utiliserait « à tort les termes de patriarcat et de domination, et entendrait monter les femmes et les hommes les uns contre les autres en disant que tous les hommes devraient avoir honte d’être hommes[8] ». Joie des avocats de la défense qui trouvent-là des alliées inattendues ! Il faut alors d’urgence explorer les notions de « masculinité », « patriarcat » en lien avec les violences sexuelles, et voir qui sont « les hommes » en ce temps où Trump, Poutine etc, sont acclamés.
Plutôt que d’accepter l’expression « culture du viol », l’autrice suggère l’idée d’un « échafaudage culturel du viol », qui explique mieux « comment la culture de nos sociétés traversée par les inégalités de genre rend possible le viol qui, en retour, renforce les inégalités de genre entre les hommes et les femmes.[9] » Elle dénonce les mythes qui sous-tendent les représentations de la sexualité. L’expression qu’elle choisit souligne mieux « le cycle vicieux des normes sociales de genres et des violences sexuelles », et l’ampleur du problème.
Elle revient alors sur la terminologie des concepts fondamentaux.
« Le concept de patriarcat a été forgé par les théoriciennes féministes pour signifier l’existence d’une oppression spécifique des femmes, en tant qu’elles sont des femmes. Ce concept renvoie à la description du monde social comme constitué entre autres par un système socio-politique qui organise l’infériorisation des femmes et la dominance des hommes. Le patriarcat n’est pas (…) le pouvoir des pères, mais ce qui lui préexiste logiquement et chronologiquement- le pouvoir des hommes[10]. »
Elle montre alors la double fonction du terme « patriarcat » par les féministes : « D’une part, il permet de souligner la spécificité de la domination masculine par rapport à d’autres formes d’oppression. (…) du simple fait qu’ils sont des hommes. D’autre part parler de ‟patriarcatˮ plutôt que de domination masculine consiste à dire que le pouvoir des hommes sur les femmes est fondé, enraciné, légitimé par une division qui est une division politique, entre sphère privée et sphère publique[11] ». N’oublions pas que jusqu’au milieu du XXe siècle au moins, l’autorité du mari sur sa femme et sur sa famille est naturelle et incontestable, en France. Si la loi a certes changé, les mentalités évoluent moins vite que le droit. Les normes sociales évoluent lentement et celle de masculinité contribue encore à structurer un ordre social hiérarchique. Manon Garcia va alors préciser la distinction entre « masculinité » et « virilité » pour mettre en évidence qu’il existe diverses masculinités hiérarchisées par la société. Ainsi, « Dissocier virilité et masculinité invite à dépasser une vision normative et à envisager des identités masculines moins dominantes et plus inclusives, tout en reconnaissant que les injonctions à la virilité jouent un rôle structurant dans les rapports de pouvoir, y compris au sein même des hommes.[12] »
L’autrice rappelle ainsi ce qui devrait désormais apparaître comme une évidence : « Lorsqu’on parle de masculinité ou de féminité, on fait donc en partie référence au fait qu’être un homme ou une femme a une signification sociale, que nos propriétés biologiques ne suffisent pas à expliquer la différence entre les hommes et les femmes[13] ». Et elle conclut : « La civilisation et la culture sont et doivent être plus fortes que les impulsions hormonales[14] ».
Revenant au cœur du procès Pélicot, Manon Garcia aborde le thème de la soumission dans un chapitre intitulé « Soumettre une femme insoumise ». C’est un thème qu’elle a déjà exploré dans On ne naît pas soumise, on le devient. Elle rappelle ce point capital : « Considérer la soumission comme la nature de la femme permet à la théologie, à la philosophie, et à la littérature classiques de justifier la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes en la faisant résulter non pas d’une domination, possiblement critiquable, de l’homme sur la femme, mais d’une soumission naturelle de la femme à l’homme.[15] » Cette approche hiérarchique exonère les hommes de leurs responsabilités puisque la soumission féminine a été « naturalisée ». Dès lors, « Tout est fait pour que les femmes acceptent de rester à ‟leur placeˮ, celle d’amantes et d’aidantes plutôt que celle d’êtres humains à part entière.[16] »
La soumission -fût-elle forcée- d’une femme aux perversions de son mari ne dispenserait-elle pas de son consentement ? Un relent d’autojustification de ce type flotte dans l’esprit de la plupart de ces criminels.
Or tous ces crimes, perpétrés par soumission chimique, montrent la réification de la victime ; et l’autrice montre comment l’audition de ce procès engendre la colère, induit à reconsidérer le « normal et le pathologique », mais elle souligne aussi le fait que Gisèle Pélicot représente la « bonne victime ».
Cette femme exceptionnelle joue un rôle majeur dans le déroulement et l’issue du procès. Sa personnalité, son milieu social, son âge, disqualifient d’avance les dérapages du genre « elle l’a bien cherché ». Chacun peut projeter sur elle une identification positive. Ce qui n’a pas empêché des allusions et soupçons déplacés. Mais ils ont été peu présents. Le danger est toujours de culpabiliser la victime, ce qui n’a guère pu se produire ici, étant donné la personnalité de Gisèle Pélicot, toujours très digne, jamais emportée.
Au terme, Manon Garcia qui avait commencé cette étude en se disant qu’il faut beaucoup aimer les hommes pour vivre avec eux (référence à Marguerite Duras[17]), se dit qu’elle s’est trompée de voie. Pourquoi ? C’est qu’au fond, les cinquante violeurs ont fait comme si Gisèle Pélicot n’était pas là. Comme dans Les Belles endormies de Kawabata, comme dans le mythe de La Belle au bois dormant, il n’y avait qu’un corps. L’existence propre de cette femme n’existe pas pour ces prédateurs.
« Dans toutes ces représentations, les femmes comme moi, comme ma mère, comme mes sœurs, comme mes amies, comme mes filles, comme mes étudiantes, des femmes qui ont des corps mais aussi des idées, des désirs, une voix, des aspirations, des plaisirs, des théories, il n’est jamais question. Nous n’existons pas. Quand j’assiste au verdict de ce procès aux côtés des femmes, des filles, des mères des accusés, ça me saute aux yeux. Elles n’ont plus, elles ne comptent pour rien.[18] ».
L’autrice se remémore alors la fin du premier volume du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, dans lequel elle montre à quel point les mythes soulignent l’inconnaissance des hommes vis-à-vis des femmes. Aujourd’hui encore, les hommes peinent à voir les femmes comme des sujets, des semblables. Ce procès montre une nouvelle fois qu’ils restent le plus souvent « prisonniers d’une incapacité socialement construite à réfléchir sur eux-mêmes, à analyser leurs émotions, à se mettre à la place des autres ». Alors plutôt que se demander s’il faut vraiment aimer les hommes, elle pense que pour vivre avec eux, « il faudrait qu’ils aiment un peu les femmes » …
Cet ouvrage incite à réfléchir bien au-delà des minutes d’un procès. Qu’aurait apporté l’ajout de la notion de consentement dans ce procès ? Ce sont les rapports humains qui sont déviants au sein de la culture dans laquelle ces crimes se commettent. Les réflexions de Manon Garcia examinent des concepts piégés qu’elle définit avec clarté. Ces mises au point sont importantes à plus d’un titre mais également pour éviter que le sujet ne dévie en altercation entre féministes à l’époque d’un nouveau backlash masculiniste quand rien, surtout pas la bible[19], ne justifie une hiérarchisation des sexes.
[1] Manon Garcia, Vivre avec les hommes. Réflexions sur le procès Pélicot, (Climats), Paris, Flammarion, 2025, p.24.
[2] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.25
[3] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.29
[4] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.31.
[5] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.31.
[6] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.35.
[7] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.59.
[8] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.65.
[9] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.70.
[10] Manon Garcia, Vivre avec les hommes. Réflexions sur le procès Pélicot, (Climats), Paris, Flammarion, 2025, p.72.
[11] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.73.
[12] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p. 81.
[13] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p. 83.
[14] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.87.
[15] Manon Garcia, Vivre avec les hommes. Réflexions sur le procès Pélicot, (Climats), Paris, Flammarion, 2025, p.100-101.
[16] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.102.
[17] « « Il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela ce n’est pas possible, on ne peut pas les supporter », Marguerite Duras, La Vie matérielle. Marguerite Duras parle à Jérôme Beaujour, Paris, P.O.L, 1987. Repris par Marie Darrieussecq : Il faut beaucoup aimer les hommes, Paris, P.O.L., 2013.
[18] Manon Garcia, Vivre avec les hommes, op. cit., p.208.
[19] Voir Sylvaine Landrivon, La Part des femmes. Relire la Bible pour repenser l’Église, Paris, Éditions de l’Atelier, 2024.