Prier le « Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes… », ou
en traduction littérale : Salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes…

Bien entendu, tous les chrétiens savent, et peut-être bien au-delà de ces croyants, que les premiers termes de la prière Je vous salue Marie rappellent la salutation de l’ange Gabriel à Marie au tout début de l’évangile de Luc : « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28). Ces mots de l’Annonciation sont associés très tôt, vers le quatrième ou le cinquième siècle, à ceux que lui adresse sa cousine Élisabeth lors de la Visitation : Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein » (Lc 1, 42).
Quel est le sens de cette salutation en forme de bénédiction ?
Une bénédiction est d’abord un don de Dieu le plus souvent accompagné d’une mission adressée à l’individu élu. Elle signale que cette personne est distinguée du groupe auquel elle appartient et déléguée auprès de son entourage dans « une relation qui les dépasse et qui les réunit[1] » nous résume la théologienne Élisabeth Parmentier dans un livre qu’elle consacre au fait d’être béni.
Ainsi dans le récit de l’évangéliste Luc, l’ange transmet à Marie la salutation de Dieu qui objective Sa venue (Annonciation) pour l’inciter au choix transgressif de concevoir un enfant hors mariage, puis Élisabeth, la cousine de Marie, prolonge cette bénédiction à vues humaines (Visitation). Les deux moments sont importants, d’où leur regroupement dans la même prière, l’un pour célébrer la verticalité de la relation divine, l’autre l’horizontalité des liens interhumains entre lesquels s’installe la présence de Dieu. L’un et l’autre sont indissociables comme le scellera définitivement le symbole de la croix.

Un premier constat révèle que dans le Nouveau Testament, c’est d’abord par les femmes qu’est reçu l’exaucement de l’attente d’Israël qui espère un Messie : Marie accueille le vœu transmis par l’ange Gabriel, et Élisabeth prend acte de son statut éminent, en la bénissant ainsi que l’enfant que Marie porte en son sein. D’ailleurs cette bénédiction de Marie, en éclairant une femme de manière privilégiée, nous rappelle que dans l’Évangile de Matthieu, Marie apparaît dans la généalogie de Jésus à la suite d’autres femmes fortes : Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, qui ont toutes des destinées particulières.
Ce lien se confirme par le fait que « Je vous salue, Marie » repose certes explicitement sur des versets du Nouveau Testament, mais sa formulation s’enracine dans les figures du Premier Testament. Cette continuité est nécessaire à la compréhension théologique du projet divin. Il importe donc de reconnaître les passages qui donnent à cette bénédiction mariale sa profondeur biblique. Parce que « le langage de bénédiction n’est pas inventé, mais découle de la mémoire biblique, qui raconte un Seigneur agissant[2] », l’élection de Marie doit conserver ses fondements vétérotestamentaires pour exprimer toute la puissance du message qu’elle porte.
La surabondance d’amour que Dieu offre à ses créatures le réjouit « et il vit que cela était très bon ». En ce sens, nous repérons que dès la création des premiers humains, Dieu les bénit (Gn1,28) et leur donne la terre en responsabilité. C’est de ce premier enracinement que se réclame celle qui sera la mère du Christ, cet être « né d’une femme » comme le rappelle sobrement Paul aux Galates (Ga4,4).
Apparaît alors dans le récit biblique la bénédiction spécifique d’Ève, la « mère des vivants » qui ne se visualise pas comme telle au premier regard. Il faut lire correctement la sentence adressée à la femme en Genèse 3,16 pour s’apercevoir, comme le fait remarquer Paul Beauchamp[3], que les termes utilisés la rapprocheraient plutôt d’une bénédiction. Le verbe utilisé je multiplierai est typiquement celui des formules de bénédiction ; mais cette première intervention est toutefois conçue comme une lecture inversée des trois composantes traditionnelles de la bénédiction que sont la fécondité, la victoire et la richesse. « On ne peut s’empêcher de voir dans cette sentence, comme en méta-message, une grande espérance, que renforce le verset 20 où l’homme, en nommant sa compagne, Ève, c’est-à-dire la Vivante, l’oriente définitivement vers la vie[4] ».
La femme biblique va ainsi se situer du côté de la « réalisation », et pourra symboliser le peuple d’Israël porteur du message d’espérance. Et si pour Saint-Irénée, Marie est la « nouvelle Ève », on peut poursuivre l’association par la référence à Genèse 3,15 : quand il est rappelé au Serpent que c’est une femme qui interviendra pour le combattre. « Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. », présumant que le « oui » de Marie serait le moyen de faire venir le salut dans le monde en accueillant le Verbe.
D’autres rapprochements scripturaires peuvent s’effectuer dans la perspective d’éclairer la bénédiction reçue par Marie. On peut comparer Marie à l’Arche d’Alliance d’Exode 25,10-22, puisqu’elle porte la présence de Dieu en son fils et qu’elle lui enseigne la Loi. On retrouvera plus tard l’annonce d’une promesse en forme de bénédiction chez Isaïe 7,14 qui annonce que « la jeune femme enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel » (Emmanuel : Dieu avec nous). On peut aussi référer Marie aux expressions « Fille de Sion », chère aux prophètes Sophonie (3,14-17) ou Zacharie (9,9) et « vierge d’Israël » : « Reviens, vierge Israël, reviens ici vers tes villes ! » couramment utilisée par Jérémie (Jr 31, 21) ou Amos (5, 2) en ce qu’elle symbolise le peuple d’Israël élu parmi tous les peuples, comme elle l’est parmi toutes les femmes. Ce choix de l’expression du plus petit qui renvoie à l’universalisation du projet dans sa formulation « Tu es bénie entre les femmes » nous oriente vers la rencontre d’Abraham qui a reçu la bénédiction de Dieu lui promettant : « Je ferai de toi une grande nation, […] En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » (Gn 12,2-3). À partir de cette alliance renouvelée, la bénédiction est promesse et engagement de Dieu qui accompagne toutes celles et ceux qui croient en lui. La suite de l’histoire du peuple élu va le manifester.
Dans le livre des Juges, alors que le peuple a désobéi à Dieu, Déborah gouverne, et l’ennemi attaque. Le général Barak ne cache pas sa peur et devant sa lâcheté, la prophétesse lui annonce que ce n’est pas lui qui sauvera le peuple mais une femme. Et, en effet, Yaël tue par ruse l’ennemi Siséra. Elle sauve ainsi le nom de Dieu et il lui est proclamé : « Bénie entre les femmes soit Yaël (la femme de Héber le Qénite), entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle ! » (Jg 5,24). Ainsi deux femmes : Déborah l’abeille et Yaël la chèvre, sauvent le pays où coulent le lait (de la chèvre) et le miel (de l’abeille). Bénies soient-elles ! Cette expérience nous prépare à une autre intervention féminine qui sauvera également les enfants d’Israël et les autels de leur Dieu : celle de Judith, qui sera acclamée de la même manière.
Ce rapprochement nous indique que l’une et l’autre sont choisies pour représenter la communauté juive et que le salut passera par leur intercession. Judith vient au secours de Béthulie ; elle sauve son peuple et le nom du Dieu Unique. Marie sera le vecteur de la révélation du Verbe qui vient s’enraciner par sa propre chair dans l’histoire du peuple élu[5]. Par conséquent, Marie n’est pas choisie comme une jeune fille au hasard. Elle est la mère du Messie parce qu’elle appartient à un peuple lui-même choisi par Dieu parmi les plus fragiles, les plus insignifiants de la région. Et elle participe activement à l’accomplissement des Écritures qu’elle connaît très bien. C’est ainsi qu’il convient de comprendre cette remarque de Luc après la naissance de Jésus : « Quant à Marie, elle conservait toutes ces choses, les méditant en son cœur[6]. » Elle est apte à enseigner et à transmettre.
On découvre alors que Marie reçoit une bénédiction qui sonne comme une réminiscence en récitant : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein » (Lc 1,42) Ce verset renvoie aussitôt le lecteur à la bénédiction dont a bénéficié Judith : « Bénie sois-tu, ma fille par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes qui sont sur la terre et béni soit le Seigneur Dieu… » (Jdt 13,18a).
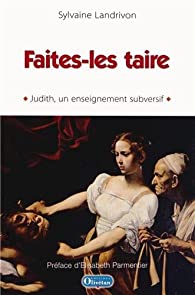
Longtemps les chrétiens s’en tiendront là dans leurs échanges avec Marie et c’est sans doute dans cette édifiante façon de porter le Christ pour le donner au monde que Charles de Foucault valorise le temps de la Visitation. Que nous suggère-t-il quand il nous propose de « Faire ce que Jésus fait faire à Marie ! » ? L’arrivée de Marie fait tressaillir la vie en Elisabeth ; la joie de la rencontre fait reconnaître à cette vieille femme qui n’attendait plus rien, que la vie rayonne en elle par la présence du Christ. Belle invitation adressée à chacune et chacun de mobiliser une foi suffisamment solide pour qu’elle agisse en tout autre jusqu’à faire vibrer en lui ou elle, le Christ qu’il ou elle porte de toute éternité. Car, si Elisabeth bénit Marie c’est que par son Fils, elle nous signifie que nous devons non seulement recevoir le don de Dieu en nous, comme elle accueille en elle un nouveau-né inespéré, mais que bien au-delà, nous sommes toutes et tous réceptacles de cette vie nouvelle et qu’à notre tour, nous saurons bondir de joie si nous parvenons à nouer ce lien d’amour. Tel serait alors le double sens ou plutôt le sens triple du geste de Marie face à sa cousine, qui le ressent ainsi : elle a reçu et offre au monde entier le fils de Dieu, elle nous invite à le porter avec elle, et enfin elle nous assure qu’elle nous accompagne chacune et chacun, comme elle a porté Jésus, dans la joie et la liberté. En cela, elle est à la fois, réceptacle de la promesse, prophétesse de la Bonne Nouvelle, sœur et mère, et jamais elle ne se prétend médiatrice ou « reine du ciel » qui se substituerait à son fils.
Mais la prière à Marie n’a pas conservé en Occident, sa radicalité première de salutation-bénédiction.
Dès la venue des drames, des grandes épidémies du quatorzième siècle, on a ajouté à la salutation de Marie une seconde partie de prière. D’abord on lui restitue le titre de Théotokos « Mère de Dieu » donné au concile d’Ephèse en 431, comme pour renforcer sa puissance. Et c’est de cette époque que datent les premières dérives vers une vénération de Marie qui prend des allures de supplication à une forme de « déesse-mère ». On a oublié que le prophète Jérémie dénonçait déjà ce travers chez les Hébreux[7] (Jr 44, 16-19). Mais là comme autrefois, la période est difficile : c’est celle des terribles pestes et de nombreux malheurs notamment pour les plus démunis, les plus pauvres. Ces personnes fragiles auraient pu réciter le Magnificat en référence à Marie, mais le pouvoir en place en Occident, oriente le peuple vers davantage de soumission et l’incite au repentir et à l’acceptation des souffrances, plutôt qu’à redresser la tête et à prendre confiance en son Dieu et en lui.
On arrive ainsi en 1568, année où le Pape Pie V prescrit aux prêtres de commencer la récitation du bréviaire par le Pater et l’Ave dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. Au commencement du dix-septième siècle, le Je vous salue Marie est en usage dans toute l’Église catholique. Ceci explique le début d’une longue période de confrontation entre les Églises chrétiennes, les Réformateurs redoutant une « foi abusée » par des pratiques pouvant conduire à l’idolâtrie. Cette tentation de la « pensée magique » n’est, en effet, jamais loin derrière les demandes de bénédiction.
Or, si la place de Marie n’est pas du tout celle de « médiatrice » puisque la première lettre à Timothée nous rappelle qu’il n’y a qu’un seul médiateur : le Christ Jésus[8] , en revanche, elle relie toute l’humanité croyante au Dieu Unique, en ce qu’elle est notre mère (Jn 19), notre sœur en Christ. Et son « oui » qui permet la venue de Dieu pour nous sauver mérite notre bénédiction.
Quant aux bénédictions, puisqu’elles relient Dieu à ses créatures et montrent la beauté des relations, pourquoi ne pas admettre avec les protestants que Tout croyant peut bénir les autres et comme le rappelle Elisabeth Parmentier à la fin de son livre Cet étrange désir d’être bénis, en citant Dietrich Bonhoeffer : « Celui qui a été béni ne peut pas ne pas transmettre cette bénédiction, plus encore : il doit, là où il est, être une bénédiction. »
sylvaine Landrivon
[1] Élisabeth Parmentier, Cet étrange désir d’être bénis, (Pratiques N°37), Genève, Labor et Fides, 2020, p.154-155.
[2] Élisabeth Parmentier, Cet étrange désir d’être bénis, op. cit., p.144.
[3] Paul Beauchamp, L’un et l’autre testament, T2, p. 153.
[4] Sylvaine Landrivon, La voie royale. Vivre l’accouchement comme une Pâque et l’oser sans anesthésie, Paris, Cerf, 2020.
[5] Reprise de Sylvaine Landrivon, La Part des femmes. Relire la Bible pour repenser l’Église, Paris, Éditions de l’Atelier, 2024, p. 133.
[6] Lc 2, 19, traduction de la Bible de Jérusalem. Dans la traduction de la TOB : « Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. »
[7] « Bien que tu nous dises cela au nom de YHWH, nous ne t’écoutons pas. Nous allons faire tout ce que nous avons décidé : brûler des offrandes à la Reine du Ciel, lui verser des libations, comme nous l’avons fait dans les villes de Juda et dans les ruelles de Jérusalem – nous-mêmes, nos pères, nos rois, nos ministres ; alors nous avions du pain à satiété et nous vivions heureux sans connaître de malheur. Depuis que nous avons cessé de brûler des offrandes à la Reine du Ciel et de lui verser des libations, nous manquons de tout et nous périssons par l’épée et par la famine.” Les femmes ajoutèrent : “Et quand nous, nous brûlons des offrandes à la Reine du Ciel et que nous lui versons des libations, est-ce sans la collaboration de nos maris que nous lui préparons des gâteaux qui la représentent et lui versons des libations ?” » (Jr44, 16-19).
[8] « Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus » (1Ti 2,5).
