Quelques versets du chapitre 16 de l’évangile de Jean se lisent comme une métaphore de l’expérience de l’accouchement et, au-delà peut-être, comme une explication de Genèse 3,16.
Que nous est-il annoncé dans ce texte de comparable à ce qui se déroule lors d’un accouchement ?
Par sylvaine Landrivon
Jésus prépare les disciples à l’idée qu’il va les quitter. Tout va changer pour eux, car il va falloir traverser l’inconcevable de la mort de Jésus sur la Croix, que Paul évoquera en termes de « scandale pour les Juifs et folie pour les païens ».
Les Douze vont devoir accepter la double séparation : celle immédiate de la perte de leur Seigneur, et celle de leur manque de foi qui les aura fait trahir et/ou fuir, quand les disciples femmes, plus perspicaces auront trouvé la force d’accompagner Jésus. Sans qu’ils l’objectivent encore, c’est ce décor que plante Jésus devant eux avant que vienne le temps de se réjouir du salut offert, de la résurrection du Christ et de l’envoi de l’Esprit. Mais à vue humaine, envisager une possibilité de joie alors qu’il n’est question que de perdre leur guide paraît hors de portée à ces hommes de bonne volonté. D’autant que ce départ s’annonce accompagné de souffrances qui ne seront pas comprises ni partagées.
Revenons au texte :
« Jésus comprit qu’ils voulaient le questionner et il leur dit : “Vous vous interrogez entre vous sur ce que j’ai dit : Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore, et vous me verrez.
En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira ; vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie.
La femme, sur le point d’accoucher, s’attriste parce que son heure est venue ; mais lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu’un homme soit venu au monde.
Vous aussi, maintenant vous voilà tristes ; mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera.
Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. » (Jean 16,19-23[1])

Si nous nous plaçons dans la dynamique de ces versets, non pas du point de vue de la situation du récit mais de celle de la métaphore, la femme sur le point d’accoucher se trouve d’abord confrontée, comme les disciples de Jésus, à l’incompréhension. En effet, dans l’épreuve du travail d’enfantement aussi bien que dans cette scène de l’évangile, il est question d’une séparation. La dissociation de la femme avec le fœtus qu’elle a porté neuf mois peut se comparer à celle de Jésus d’avec ses amis. Dans les deux cas, il faut quitter le confort rassurant de la complicité fusionnelle, et le délai, la durée : « dans peu de temps », « encore un peu », semblent poser problème. Pour celui, celle, qui ne maîtrise pas la situation, l’heure de la dernière épreuve à affronter, difficile à appréhender, apparaît péniblement proche. L’incompréhension appelle donc une clarification ou du moins cherche à saisir ce qu’il est possible de transmettre concernant ce qui se trame.
Les personnages sur lesquels devraient se focaliser le regard sont Jésus d’une part et l’enfant à naître d’autre part. Or le texte montre que ce n’est pas le destin du Christ -dans le texte- ou celui du bébé, dans l’environnement du vécu de l’accouchement, qui suscite une explication mais celui des disciples (ou de la femme) impliqués dans les turbulences du moment présent.
C’est ainsi que la réaction des disciples est décrite comme un mouvement allant de la tristesse à la joie. Prise dans le contexte du départ imminent de Jésus, cette tristesse fait contraste avec l’indicible joie que ses amis éprouveront au terme de l’aventure. S’ils avaient pleinement reçu le message de leur compagnon de route, cette peine aurait dû être légère tant la suite du processus a été annoncée et décrite. Ils prétendent avoir reconnu en Jésus, le Messie, le Christ, venu pour le salut du monde. Ils ont peur pourtant car le basculement vers un avenir inconnu est trop difficile à appréhender et les prend au dépourvu. Alors là où il devrait être question de lumière et de joie, l’heure est à l’inquiétude. Le paradoxe est d’autant plus frappant que c’est du cœur même de cette déstabilisation nécessaire que jaillira la joie.
Pour bien ancrer le sens et les conséquences de la métaphore, le rédacteur johannique la développe et l’illustre en choisissant précisément la parabole de la femme en couches. Sans entrer dans les détails précis du parallélisme que nous abordons, l’image de l’accouchement évoque une expérience universelle, accessible à chacun et surtout à chacune, quelle que soit sa culture. Elle s’exprime toutefois ici dans un registre un peu particulier car il n’est pas habituel de parler de « tristesse » pour l’accouchement ni de dire de la mère qu’elle ne se souvient plus de son « affliction ». Le champ lexical employé est davantage celui de la douleur. Mais ce glissement n’est pas fortuit de la part du narrateur qui veut mettre en évidence tout se qui se joue dans le mouvement de l’existence croyante.
Le choix du terme tristesse renvoie à la proximité d’une absence, d’un manque : celui de Jésus qui va mourir, comme celui qui va signer la fin de la grossesse, la déconstruction du bébé « à soi », « pour soi », au profit d’un nouvel être vivant bien réel et autonome. Dans cette tristesse, peut également se deviner la perte d’une sensation de complétude, la peur à traverser, et l’inquiétude quant à la manière individuelle de vivre l’épreuve.
Mais dans les deux événements, la joie a précisément son origine dans cette traversée, si bien que celle-ci est à recevoir comme constitutive de l’expérience. C’est d’elle que viendra l’illumination de la vie ; vie humaine lors de l’accouchement, Vie dans la promesse du salut pour le croyant.
D’autre part, dans les deux situations superposées, il convient de remarquer qu’en aucun cas, il ne peut se produire de retour à l’état antérieur. La joie de la Résurrection du Christ transformera à jamais ceux qui accueillent cette Bonne Nouvelle, de même que le bonheur de tenir son enfant dans ses bras fera de la femme un être à jamais autre. La vie de la parturiente acquiert une dimension nouvelle en donnant naissance à son enfant. L’exégète Jean Zumstein note que « le point décisif de l’image tient dans le fait que, pour parvenir à la joie de la naissance, la femme en couches doit faire l’expérience des maux de l’enfantement. L’un ne va pas sans l’autre.[2] » Bien que père de famille, ce théologien protestant, professeur d’université, semble ne pas avoir retenu dans son analyse l’évolution apportée par la systématisation de l’anesthésie péridurale. Quel dommage en effet que notre civilisation prétendue évoluée oriente désormais toutes les femmes, généralement sans information psychologique et spirituelle préalable, vers la solution de facilité qu’est l’accouchement sous péridurale. Par sa systématisation, le milieu médical détourne ainsi celles qui pourraient bénéficier pleinement de la richesse d’une expérience à nulle autre pareille, en les incitant fermement à la contourner, à la fuir dans l’inconscience, même quand leur santé ou celle de leur bébé n’est pas en jeu.
Car il est probable que par la médiation de cette douleur hors du commun, on accède à un autre degré de « savoir ». Celui, précisément, qui manque aux Douze au moment où Jésus s’adresse à eux.
Et si le rapport à la Vie n’est peut-être pas absolument « compris », -nous ne sommes plus dans l’ordre d’une connaissance intellectuelle- un élargissement de l’horizon est ouvert ; et comme le dit Jésus à ses apôtres : « cette joie, nul ne vous la ravira[3] ». C’est sur ce seuil de connaissance du sens profond de la vie comme Don gratuit et accueil en plénitude que la quête d’Ève trouve son horizon de réponse.
Cette joie lumineuse qui accueille la naissance ou les « retrouvailles » des disciples avec Jésus ressuscité, est approchée dans ce qu’enseigne l’œuvre du philosophe Plotin. En ce sens, le professeur Pierre Gire écrit, au cours d’une étude sur le salut dans le néoplatonisme :
« Mais pour s’éclairer de la lumière du Principe, le vivant doit abandonner les épaisseurs de l’ordinaire des jours : les attachements multiples, les pesanteurs oppressantes, les protections surajoutées, bref les puissances de l’ombre, et devenir comme Ulysse revenant chez lui, dévêtu, après son tour du monde. [4] »
Effort de dépouillement, de dépossession de soi, puis contemplation, et illumination. Ce qu’a pu retrouver le néoplatonisme de similaire à l’expérience de l’accouchement c’est que ce n’est pas une forme de connaissance ou de langage qui permet d’éprouver la présence de Dieu. Il s’agit par l’une ou l’autre voie d’éprouver, sur le mode certes tangentiel, une réelle expérience d’union mystique. Or dans les cas extrêmes, et toute séparation vraie en est un, nous retrouvons clairement les étapes décrites classiquement dans l’expérience mystique. Tout d’abord une passivité radicale, de l’ordre du « lâcher-prise », autrement dit qui abandonne toute intentionnalité propre et se dépouille de l’orgueil d’une impossible maîtrise. Ensuite il s’agit d’une épreuve de dépassement de soi, qui accepte de ne rien savoir, de ne plus rien avoir, tout en éprouvant un sentiment de totalité qui conduit à une forme de connaissance intuitive et unitive qui exige une désimagination de soi et de tout le reste. Il faut oser devenir comme la rose d’Angélus Silesius : sans pourquoi[5] et accepter par amour de s’ouvrir totalement sans plus rien faire ni vouloir.
Pour y parvenir, il faut oser plonger dans le mystère, malgré la peur. L’horizon de lumière qu’est la naissance d’un nouvel être, qu’il soit de chair comme dans l’accouchement, ou spirituel comme celui dont parle St Paul aux Corinthiens, doit nous donner suffisamment de confiance, de foi, pour franchir l’épreuve de la peur, qu’elle soit de mort ou de vie.
Mais, si évidente a posteriori lors d’un accouchement, quelle foi faut-il pour entendre, dans d’autres circonstances de séparation : « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera. »
Les évangiles et particulièrement celui de Jean semblent illustrer une meilleure disposition des femmes pour cette posture. Par essence, par nature, par choix ? Elles sont présentes au pied de la croix et présentes au tombeau. Disponibles et curieuses d’aimer toujours plus loin.
Texte repris à partir d’un chapitre de La voie royale. Vivre l’accouchement comme une Pâque et l’oser sans anesthésie, paru aux éditions du Cerf, 2020.
[1] Jean 16,19-23, in TOB, Paris, Éditions du Cerf, 2000.
[2] Jean Zumstein, Commentaire du Nouveau testament deuxième série IVb L’évangile selon saint Jean (13-21), Genève, Labor et fides, 2007, 324p., p.147.
[3] Jean 16,22.
[4] Pierre Gire, « Le salut par la conversion dans le néoplatonisme de Plotin » in Esprit et vie, N° 04 (1996), p. 201.
[5] Angelus Silesius, Le pèlerin chérubinique, (sagesses chrétiennes), Trad. Camille Jordens, Paris, Éditions du Cerf, 2007, Livre I, 289 : « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle fleurit, elle ne se soucie pas d’elle-même, elle ne se demande pas si on la voit. », p. 97.
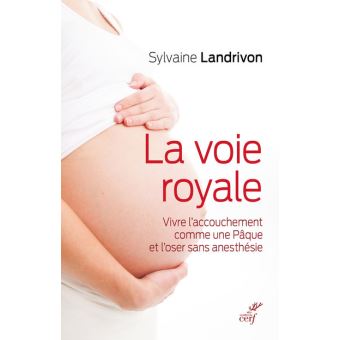
J’aime bien la peinture de Sr Catherine Bourgeois
Par sylvaine Landrivon (illustration sr Catherine Bourgeois)
Qui vous a donné permission de vous en servir ?
Bonjour, j’avoue n’avoir rien demandé dans la mesure où elle était sur Internet et que je cite l’auteure. Je me suis dit que c’est une façon d’honorer cette femme qui peint par ailleurs de magnifiques visages de Christ. Si vous savez comment la contacter, merci de me l’indiquer;je lui demanderai l’autorisation avec joie. Et si vous pensez mon illustration déplacée malgré la référence, je veux bien en changer… mais je ne pensais pas commettre une faute ; plutôt rendre hommage.
Merci beaucoup Sylvaine.
Cela me rappelle que c’est à l’heure la plus sombre de la nuit que pointe la lumière de l’aube.
C’est bien du manque que viens le besoin.
C’est bien l’inconfort qui nous met en marche.